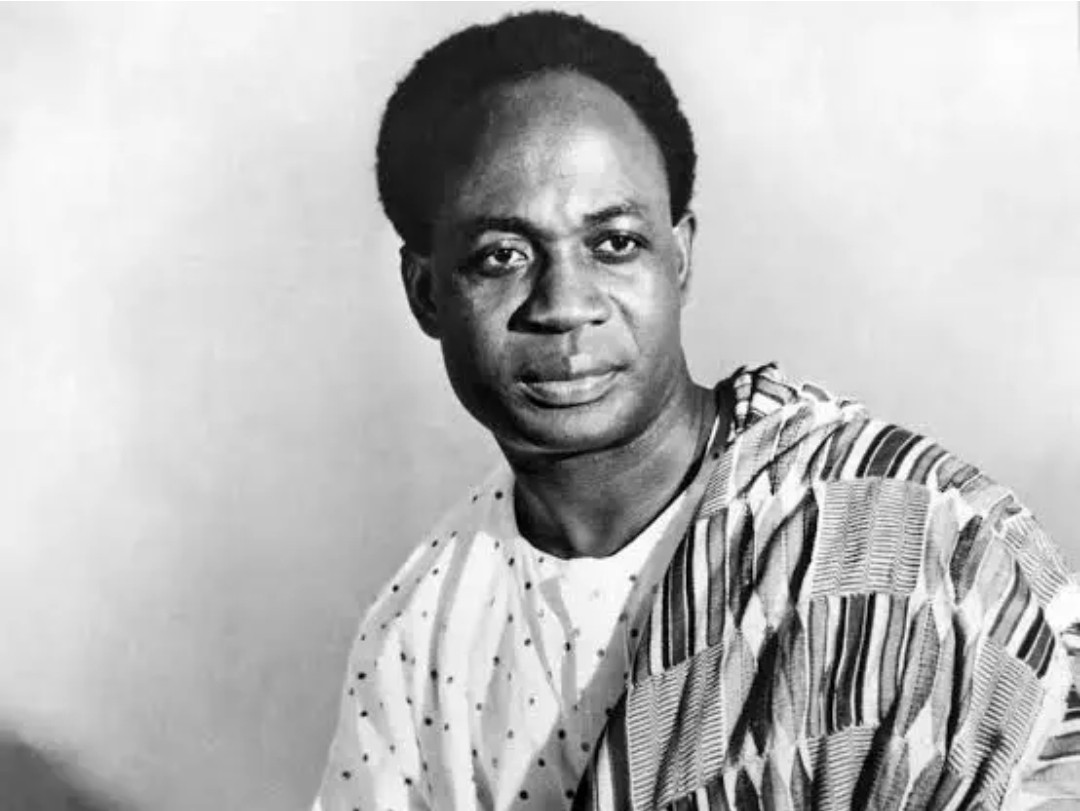Complément cours commentaire composé 1ère A4
Compétence attendue : Étudier un texte afin de présenter, de manière ordonnée et structurée, son bilan de lecture justifié par une analyse et une interprétation de ses faits d’écriture.
Texte : « Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare … Deux figures allégoriques, deux femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient l'enseigne : Au Bonheur des Dames.
Emile Zola, Au Bonheur des dames (1883), extrait du chapitre 1.
Vous ferez de ce texte un commentaire composé, sans séparer le fond et la forme. Vous analyserez, par exemple, la découverte du cadre du roman et des personnages, ensuite la description du grand magasin.
La découverte de l’exercice.
Le commentaire composé est un exercice qui consiste à présenter, de manière structurée et ordonnée, un bilan de lecture du texte proposé, justifié par un relevé d’outils d’analyse pertinents. Le candidat doit analyser profondément chacun des constituants de cet exercice : le texte, le paratexte et la consigne.
La consigne, ici, est à la fois contraignante et suggestive. Elle est constituée d’une injonction qui précise le type de production, de la proposition d’un contenu à étudier, des indications sur les procédés d’écriture à observer (cet élément est souvent absent), d’une invitation éventuelle à prolonger la recherche (à travers l’expression « par exemple », la formule « etc. », la ponctuation « … » ou l’emploi du conditionnel).
L’élaboration du plan détaillé.
Un plan détaillé pour un exercice de commentaire composé comporte les axes de lecture ou grandes parties du texte (2 ou 3), chaque axe de lecture est constitué de 2 ou 3 sous axes de lecture illustrés par des outils de la langue (outils d’analyse ou procédés d’écriture). Construire à chaque fois une transition pour passer d’une partie à une autre.
Les centres d’intérêt sont trouvés après une étude de la consigne et du texte. Ensuite, le candidat fait une lecture du texte en fonction de ces centres d’intérêt et à partir des outils d’analyse suivants :
Le lexique : les champs lexicaux, le vocabulaire appréciatif et dépréciatif, le vocabulaire des sens, les connotations.
L’énonciation
Les figures de style
La syntaxe : temps et modes verbaux, types de verbes (d’action, d’état, modalisateurs), les types, formes et structures de phrase, la ponctuation, les connecteurs logiques, les indicateurs spatio-temporels.
Les tonalités littéraires
Les sonorités : allitérations et assonances.
Le rythme des vers et de la phrase
Etc.
La production d’une introduction.
Une introduction de commentaire composé débute par un alinéa et se rédige en un « bloc » de trois parties :
La situation du texte (inscrire le texte dans son contexte : historique ou littéraire; présenter l’œuvre : auteur, œuvre, genre, thèmes directeurs; localiser le texte : références…);
La présentation de l’idée générale (sans être vague : ex.la rupture amoureuse);
L’annonce du plan (Qu’allons-nous faire ? centres d’intérêt ou axes d’étude).
Exemple :
Écrivain français du XIXe siècle, Émile Zola est l’auteur du roman Au Bonheur des Dames, publié en 1883. Cette œuvre romanesque raconte la transformation du commerce, à travers le parcours de Denise Baudu. Et dans l’incipit du roman, extrait du chapitre un, elle arrive à Paris, accompagnée de ses deux frères et découvre le grand magasin « Au Bonheur des Dames ». L’analyse de ce texte revient à montrer comment s’expriment la découverte du cadre du roman et des personnages, ensuite la description du grand magasin.
La production d’une conclusion.
Une conclusion de commentaire composé débute par un alinéa et se rédige en un « bloc » de trois principales parties :
- Bilan /résumé / récapitulatif du développement (la synthèse des sous-centres d’intérêt);
- Intérêts /portée du texte /originalité du texte (intérêts littéraire, stylistique, dramatique, psychologique, social, historique, philosophique, économique, religieux, …).
- L’ouverture ou l’élargissement du texte (étape facultative)
Exemple : (Cette conclusion ne comporte pas l’ouverture ou l’élargissement du texte.)
En somme, ce début de roman plonge le lecteur dans un cadre spatio-temporel réaliste où trois personnages pauvres et orphelins arrivent pour la première fois. Ils sont fascinés, dans ce Paris matinal, par le puissant magasin « Au Bonheur des Dames », véritable temple du capitalisme. Ainsi cet incipit est intéressant du point de vue social en raison de la situation pathétique de ces personnages et du point de vue littéraire par la mise en place des principaux éléments de l’histoire.
La production d’un paragraphe
Au commentaire composé, c’est dans les paragraphes du développement qu’on associe la forme (outils d’analyse ou procédés d’écriture) et le fond (leurs interprétations). Et toute interprétation doit s’appuyer sur des citations du texte. Ces citations doivent comporter des procédés d’écriture clairement analysés (identification, puis caractérisation ou description).
Un paragraphe du développement s’ouvre sur une phrase d’introduction qui met en valeur l’idée directrice du paragraphe (le sous-centre d’intérêt). Et il se ferme sur une phrase de conclusion qui reprend cette idée directrice en d’autres termes.
N.B.: * Il ne faut pas trop citer le texte.
* Il ne faut pas citer de très longs passages du texte ; il faut être précis dans le découpage des citations.
* Quelques verbes pour associer le fond et la forme : traduire, mettre en relief, mettre en évidence, exprimer, sous-entendre, montrer, produire un effet (de), créer un effet (de), renforcer l’impression de, rendre compte de, faire naître, évoquer, présenter, souligner, insister sur, suggérer, faire apparaître, etc.
Exemple :
Le lecteur découvre le cadre de l’histoire. Le narrateur présente les lieux à travers des indicateurs : « la gare Saint-Lazare », « un train de Cherbourg », « au milieu du vaste Paris », « la place Gaillon », « à l’encoignure de la rue Michodière et de la rue Neuve-Saint-Augustin », « Saint-Roch », « Valognes ». Ces indices spatiaux sont nombreux. Ils révèlent que le roman débute à Paris, une ville immense pour les personnages qui sont venus de « Valognes » en train. Le narrateur y associe les indices temporels : « dans la douce et pâle journée d’octobre », « huit heures sonnaient », « le Paris matinal ». Ils sont peu cités mais précis. Ils situent le début de cette histoire le matin, un moment qui peut symboliser le commencement d’une période nouvelle dans la vie des personnages. L’abondance des indicateurs spatio-temporels montre que cette œuvre romanesque est ancrée dans la réalité. C’est donc un roman réaliste.
L’organisation d’une partie du développement
Une partie du développement est constituée d’une introduction partielle et des paragraphes (deux au moins, trois au plus) qui développent chacun un aspect de l’axe d’étude.
L’introduction partielle énonce le centre d’intérêt et les sous-centres d’intérêt, en une ou deux phrases.
Les connecteurs logiques établissent des liaisons entre les paragraphes afin d’assurer la continuité et la cohérence entre eux. On peut aussi annoncer le paragraphe suivant dans la conclusion du paragraphe précédent ou rappeler le paragraphe précédent au début du paragraphe suivant.
La cohérence logique d’une partie est assurée également par la répétition de certains mots ou de certaines expressions d’un paragraphe à l’autre.
N.B. Un développement de commentaire composé est constitué de plusieurs parties (deux ou trois).
Exemple :
Cet incipit informe le lecteur sur le cadre du roman et sur certains personnages majeurs.
Tout d’bord, le lecteur découvre le cadre de l’histoire. Le narrateur présente les lieux à travers des indicateurs : « la gare Saint-Lazare », « un train de Cherbourg », « au milieu du vaste Paris », « la place Gaillon », « à l’encoignure de la rue Michodière et de la rue Neuve-Saint-Augustin », « Saint-Roch », « Valognes ». Ces indices spatiaux sont nombreux. Ils révèlent que le roman débute à Paris, une ville immense pour les personnages qui sont venus de « Valognes » en train. Le narrateur y associe les indices temporels : « dans la douce et pâle journée d’octobre », « huit heures sonnaient », « le Paris matinal ». Ils sont peu cités mais précis. Ils situent le début de cette histoire le matin, un moment qui peut symboliser le commencement d’une période nouvelle dans la vie des personnages. L’abondance des indicateurs spatio-temporels montre que cette œuvre romanesque est ancrée dans la réalité. C’est donc un roman réaliste.
Ensuite, le lecteur découvre les personnages Denise, Pépé et Jean. Un vocabulaire particulier les caractérise : « les vieux vêtements du deuil de leur père », « tous les trois brisés du voyage », « effarés et perdus ». Il s’agit d’un vocabulaire péjoratif qui met en relief leur situation pathétique. Ils sont pauvres, orphelins et désorientés dans une ville de Paris où ils viennent, sans doute, chercher le bien-être. Ces personnages sont, par la suite, présenté de manière plus précise. Pépé est décrit, objectivement, par les expressions « le petit frère », « âgé de cinq ans », « se pendait à son bras ». Il se présente comme un enfant fragile, très attaché à sa sœur. Cette dernière apparait « chétive pour ses vingt ans », avec « l’air pauvre ». Elle est caractérisée négativement comme une jeune femme fragile à l’allure populaire. Quant à Jean, il est décrit par la subordonnée relative « dont les seize ans superbes florissaient » et les adjectifs qualificatifs dans les expressions : « le grand frère », « les mains ballantes ». Par ces mots mélioratifs, le narrateur laisse entrevoir un bel adolescent qui semble insouciant. Ainsi, sa situation est moins pathétique que celle des autres.