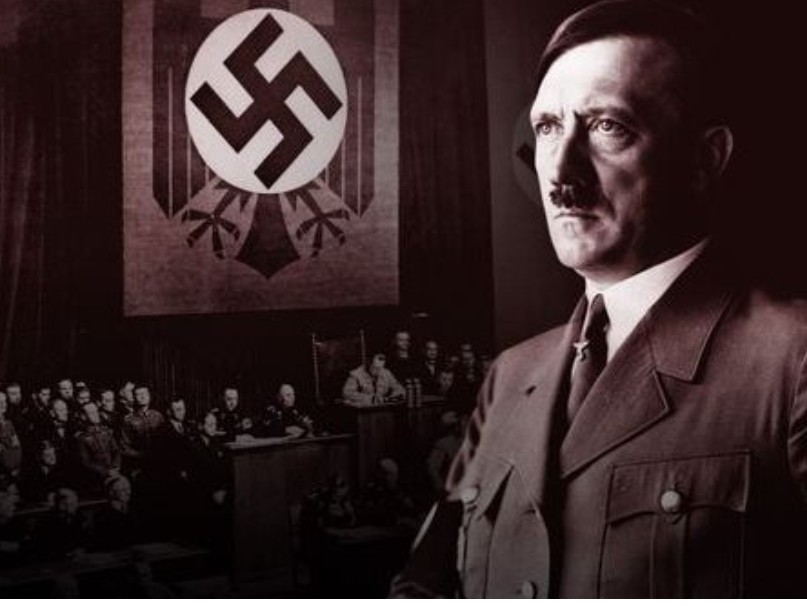Définitions de la philosophie
Introduction
Pascal écrivait : "se moquer de la philosophie, c' est vraiment philosopher." Dans cette logique, même les ennemis de la philosophie philosophent sans le savoir. Karl Jaspers ajoute : "l'homme ne peut pas se passer de philosophie. Aussi est-elle présente partout et toujours répandue dans le public." La philosophie est donc incontournable à l'humain. Il est urgent de cerner la notion de philosophie. Il est difficile d'avoir une définition unanimement acceptée de la philosophie. Chaque philosophe a en fait sa propre conception de la philosophie. Il y a une multitude de définitions de la philosophie. Mais parmis ces définitions, il y en a qui expriment mieux la discipline philosophie. Ce sont ces définitions qui font l'objet de ce cours.
I- Ce que la philosophie n' est pas
1- Une science expérimentale
La philosophie n' a pas pour but de faire ressortir des vérités en utilisant les expériences. Ses vérités n' ont pas pour but d'être définitives et partagées par tous. Karl Jaspers précise d'ailleurs que les questions sont plus importantes en philosophie que les réponses. Le but n' est donc pas la recherche des vérités définitives. Wittgenstein affirme : "La philosophie n’est aucune des sciences de la nature".
2- Une science morale
Elle ne vise pas à établir des règles de vie devant être respectées par tous et contrôlées par des institutions.
3- un dogme
La philosophie s'opppse à la religion. Elle n' a pas la prétention d'établir des dogmes et des vérités éternelles. Elle ne pense pas que le salut de l'homme viendra de son abandon aux forces surnaturelles. Pour la philosophie, l'homme seul trouve son salut. Hegel écrit :"La philosophie est le fondement du rationnel, elle est l’intelligence du présent et du réel et non la construction d’un au-delà qui se trouverait Dieu sait où”.
II- Ce que la philosophie est
1- Une science critique
Marcien Towa précise que la philosophie est essentiellement critique. Elle soumet tout à la critique : Dieu, le pouvoir politique, les traditions, les rites... La philosophie critique tout, elle remet tout en question. Marcien Towa écrit : "la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance". La philosophie a donc le courage de tout critiquer. Towa ajoute : " la philosophie est essentiellement sacrilège". Elle ne reconnaît donc pas le sacré. Elle a pour but de mettre fin au sacré.
2- La science du questionnement
Philosopher c' est poser des questions pour comprendre. On interroge tout. Pourquoi il pleut? Pourquoi les montagnes? Pourquoi sommes-nous sur terre? Philosopher en fait c'est questionner. Karl Jaspers écrit : "Les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question." Il ajoute: "philosopher c' est être en route". Il ne s'agit pas d'être en route pour aller au restaurant manger, mais être en route pour la recherche de la vérité, en utilisant le questionnement. En questionnant on arrête avec les habitudes, on détruit les préjugés. S'interroger c' est penser, réfléchir, trouver des solutions. Le questionnement est le fruit de l'étonnement. C' est l'étonnement qui pousse au questionnement. La philosophie est donc aussi liée à l'étonnement. Schopenhauer écrit : "La philosophie naît de notre étonnement au sujet du monde et de notre existence”. Husserl ajoute:"Quiconque veut devenir philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même." Replier sur soi pour réfléchir et questionner. Aristote poursuit : "À l'origine comme aujourd'hui, c'est l'étonnement et l'admiration qui conduisirent les hommes à la philosophie."
3- La philosophie comme la science des causes premières
Aristote considère la philosophie comme toute recherche et toute connaissance scientifiques. Elle s'occupe des principes les plus élevés et des premières causes des choses. Elle recherche l'origine des choses, et non les à priori, c' est pourquoi Aristote la considère comme la science des causes premières. C' est la science des premiers principes, la science de la réalité véritable. Pour Aristote, les éléments ont des principes qui sont présents et agissent partout. Ces principes font de l'ensemble des phénomènes un véritable univers. La philosophie recherchent donc ces principes communs.
4- La philosophie comme mère des sciences
Pour Descartes, la philosophie contient toutes les sciences. Elle est la mère des sciences. Son fondement est la métaphysique, qui étudie les éléments invisibles comme la religion, la magie... Il écrit : "Ainsi toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences, qui se réduisent à trois principales, à savoir, la médecine, la mécanique et la morale. » En fait la philosophie n' est étrangère à aucune science. Les plus grands philosophes sont des scientifiques et vice-versa. On peut citer Descartes lui-même, Einstein, Thalès de Milet... Toute connaissance part de la théorie, du questionnement, qui est le propre de la philosophie. Avant d'élaborer la théorie de la poussée d'Archimède, Archimède se rend compte que certains corps sur l'eau ne coulent pas. Il en déduit que l'eau exerce une force sur les corps. A ce niveau il est encore philosophe. Il devient scientifique quand il entreprend de calculer la force que l'eau exerce sur les objets. Pareil pour la théorie des actions réciproques ou l'attraction universel de Newton. Au fondement de toutes ces connaissances scientifiques de trouve donc la théorie, qui relève de la philosophie. La philosophie dans l'histoire étudiait tout. Mais avec le temps, chaque science s'est séparée de la philosophie. Mais toutes ces sciences sont restées en relation avec la métaphysique qui assure leur lien commun. Ce qui pousse Descartes à prendre la métaphysique comme les racines de la philosophie. Aussi, toute science a sa philosophie
La science devient philosophique quand elle recherche son objet, discute sa propre méthode ou ses rapports avec les autres sciences.
5- La philosophie comme l'amour de la sagesse
Pythagore définit la philosophie comme l'amour de la sagesse. En effet, Philosophie provient de deux termes grecs: philo ou Philein (amour) et sophia (sagesse). Autrement dit, la philosophie est l'amour de la sagesse. La philosophie recherche donc âprement et inlassablement ma sagesse, les connaissances. Descartes précise à cet effet : "Ce mot de philosophie signifie l’étude de la sagesse et par la sagesse on entend une parfaite connaissance de toutes les choses que l’homme peut savoir." Aristote fait de la recherche de la connaissance l'une des principales caractéristiques de l'homme. Il écrit : "l'homme a naturellement la passion de connaître".
6- La philosophie comme recherche de la vérité
Cette définition suit celle déjà faite par Aristote selon laquelle la philosophie est la recherche des causes premières. Ces causes premières peuvent être assimilées à la vérité. La philosophie recherche donc la vérité. Elle ne se fie pas aux à priori ou aux préjugés. Aristote écrit : "C’est à bon droit que la philosophie est appelée science de la vérité".
Conclusion
Cette leçon permettait de mieux cerner la notion de la philosophie. Cerner cette notion est la base à toute étude de la philosophie. Sans connaître la notion, ce qu'elle est et ce qu' elle n' est pas, nous pouvons plus aisément l'apprendre ou la pratiquer. Elle n' est pas une science exacte, ni un ensemble de dogmes. Elle est la science des causes premières, la recherche de la vérité et de la sagesse, une science critique. Elle est la science du questionnement et de l'étonnement, la mère des sciences.
Avez-vous bien lu le cours ? Répondez aux questions suivantes.
1- Quelle est l'idée principale véhiculée par Pascal à propos de la philosophie ?
A) La philosophie est inutile.
B) Même ceux qui se moquent de la philosophie la pratiquent sans le savoir.
C) La philosophie est une science expérimentale.
D) La philosophie est réservée à une élite intellectuelle.
2- Pourquoi est-il difficile de définir la philosophie de manière unanime ?
A) Parce que chaque philosophe a sa propre conception de la philosophie.
B) Parce qu'elle n'a aucune définition claire.
C) Parce qu'elle est une science morale.
D) Parce que la philosophie change constamment.
3- La philosophie n'est pas une science expérimentale car :
A) Elle utilise uniquement des méthodes scientifiques.
B) Elle n'a pas pour but de découvrir des vérités définitives par l'expérience.
C) Elle produit des résultats vérifiables par l'expérience.
D) Elle dépend des dogmes religieux.
4- La philosophie n'est pas une science morale car :
A) Elle ne cherche pas à établir des règles de vie universelles et normatives.
B) Elle impose des règles que tout le monde doit respecter.
C) Elle repose sur des vérités éternelles.
D) Elle se concentre uniquement sur l'étude des phénomènes physiques.
5- Pourquoi la philosophie s'oppose-t-elle au dogme ?
A) Elle soutient que l'homme doit s'en remettre aux forces surnaturelles.
B) Elle considère que le salut de l'homme vient de sa soumission aux dogmes religieux.
C) Elle remet en question les vérités éternelles et les dogmes.
D) Elle défend les dogmes religieux comme source de vérité absolue.
6- Comment Marcien Towa définit-il la philosophie ?
A) Comme la science de la morale.
B) Comme une science critique qui soumet tout à l'examen.
C) Comme un ensemble de dogmes.
D) Comme une méthode pour prouver l'existence de Dieu.
7- Selon Karl Jaspers, quelle est l'essence de la philosophie ?
A) Trouver des réponses définitives à toutes les questions.
B) Se poser des questions pour mieux comprendre la réalité.
C) Accepter les traditions et les rites sans les remettre en question.
D) Définir des principes religieux.
8- Pourquoi dit-on que la philosophie est liée à l'étonnement ?
A) Parce que les philosophes sont souvent surpris par les découvertes scientifiques.
B) Parce que l'étonnement est à l'origine du questionnement philosophique.
C) Parce qu'elle traite de phénomènes mystérieux et incompréhensibles.
D) Parce que les philosophes sont souvent sceptiques.
9- Selon Aristote, pourquoi la philosophie est-elle la science des causes premières ?
A) Elle se concentre sur les effets visibles des phénomènes.
B) Elle explore les principes fondamentaux et les origines des choses.
C) Elle repose uniquement sur des expériences scientifiques.
D) Elle se limite à l'étude de la matière et de l'énergie.
10- Pourquoi Descartes qualifie-t-il la philosophie de "mère des sciences" ?
A) Parce qu'elle inclut toutes les autres sciences.
B) Parce qu'elle est basée uniquement sur des faits vérifiables.
C) Parce qu'elle est réservée aux scientifiques.
D) Parce qu'elle rejette les sciences modernes.
11- Que signifie l'expression "l'amour de la sagesse" dans le contexte de la philosophie selon Pythagore ?
A) La recherche de la connaissance pour des gains matériels.
B) Le désir d'acquérir la sagesse et la connaissance.
C) Le rejet de toute forme de connaissance pratique.
D) La poursuite des plaisirs sensoriels.
12- Quelle est la relation entre la philosophie et la vérité selon Aristote ?
A) La philosophie rejette la recherche de la vérité.
B) La philosophie est appelée la science de la vérité, car elle cherche à comprendre les causes premières.
C) La philosophie ne se préoccupe que des opinions et des croyances.
D) La vérité n'a aucune importance pour la philosophie.
13- Quelle est la conclusion principale du cours sur la philosophie ?
A) La philosophie est une science exacte.
B) La philosophie est une science du questionnement, de l'étonnement et de la recherche de la vérité.
C) La philosophie est une religion moderne.
D) La philosophie n'a aucun lien avec les autres sciences.
Réponses aux questions :
1- B
2- A
3- B
4- A
5- C
6- B
7- B
8- B
9- B
10- A
11- B
12- B
13- B