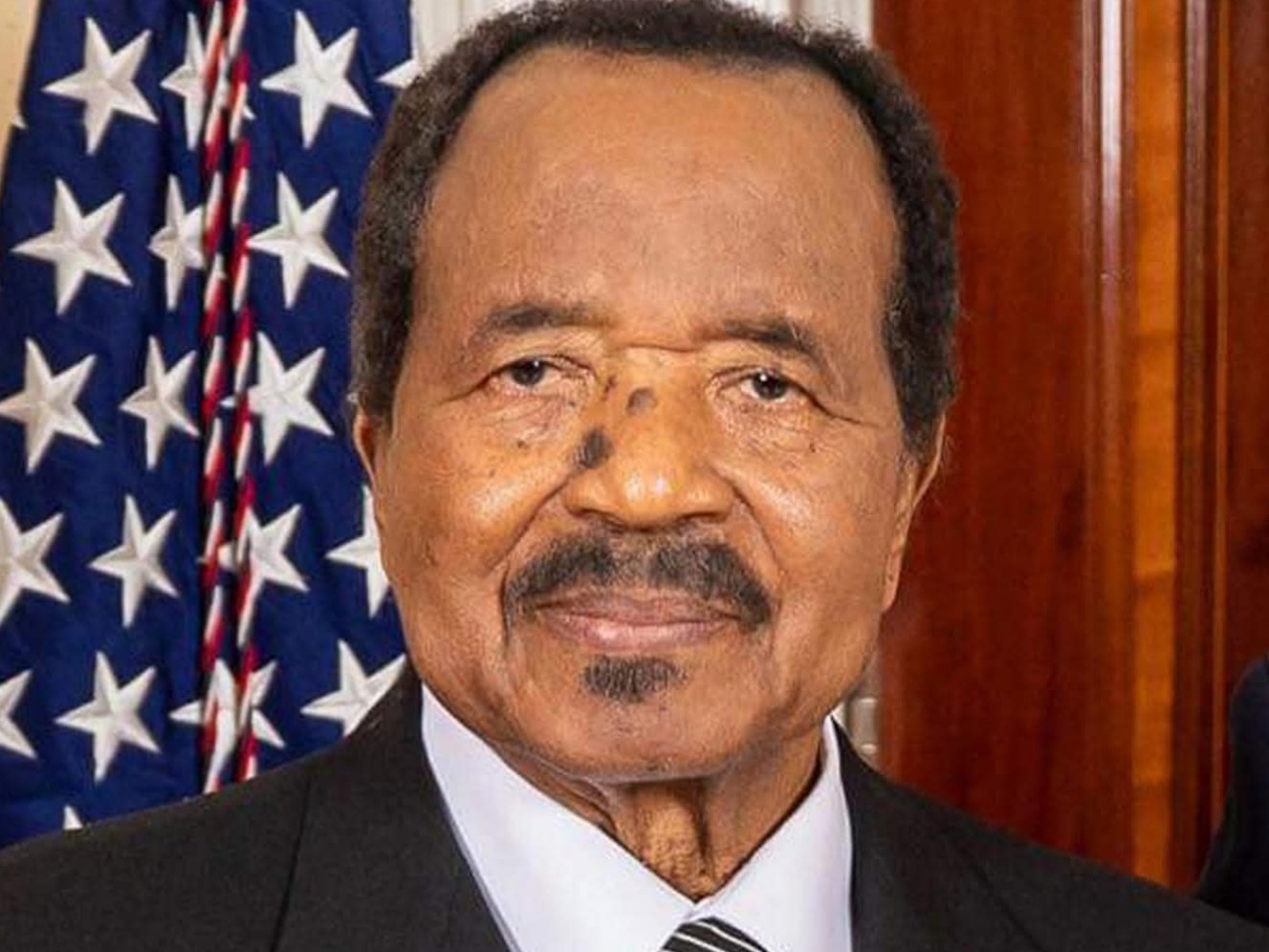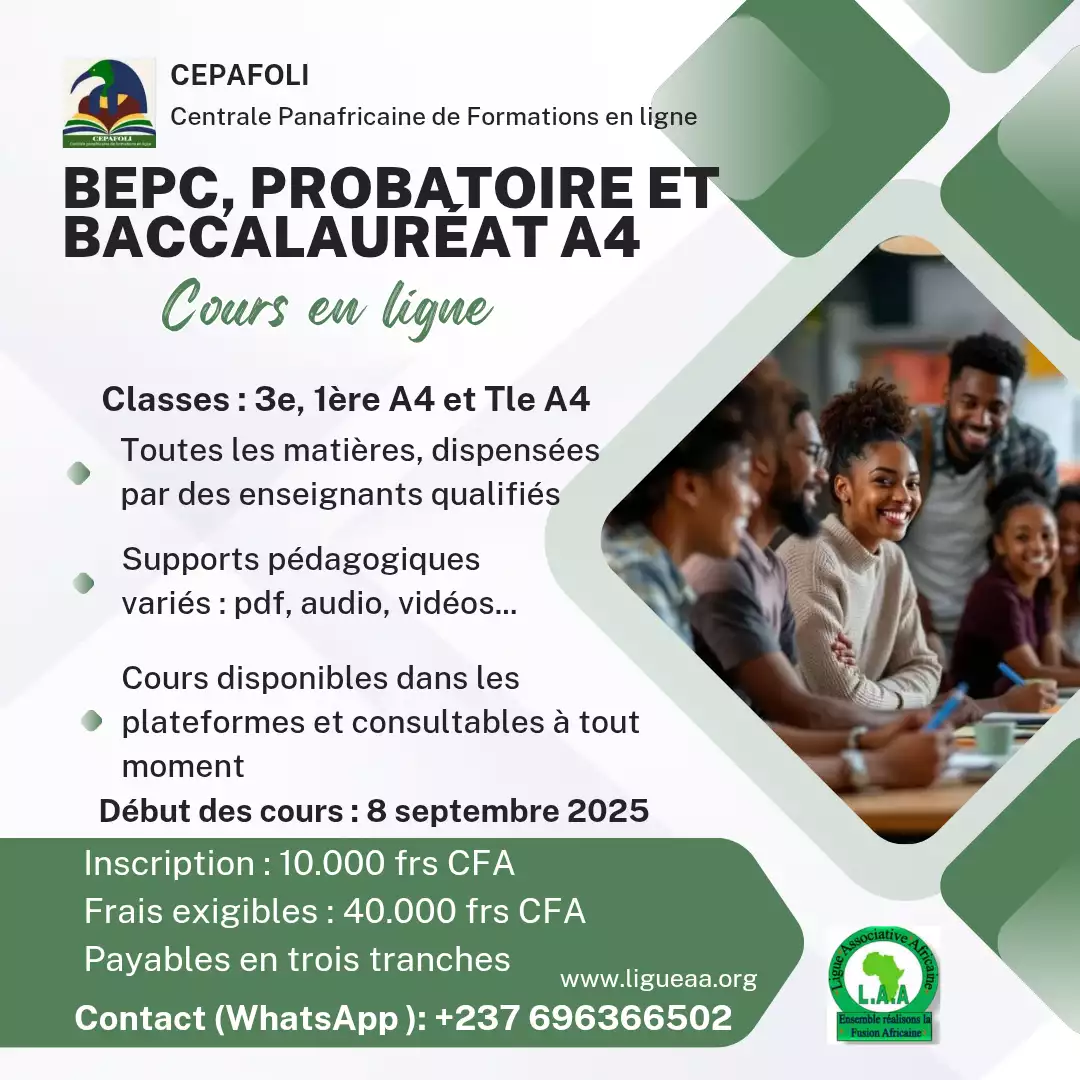Leçon : METHODOLOGIE DU COMMENTAIRE DE TEXTE PHILOSOPHIQUE
Introduction
Le commentaire de texte philosophique est un exercice qui permet de développer la capacité d'analyse dialectique de l'apprenant. L'élève doit être capable de comprendre un texte, de le réfuter et de faire ressortir sa valeur. Il doit être capable de critiquer le texte d'un auteur par des arguments valables. Le commentaire de texte philosophique se fait en trois parties : Une introduction, un développement et une conclusion.
I- Le travail préliminaire
Avant de commencer la rédaction du commentaire de texte philosophique proprement dit, il faut un intense travail préparatoire.
1- La lecture plurielle du texte
L’apprenant doit lire trois à quatre fois le texte pour le comprendre. Il faut adopter une attitude de neutralité vis-à-vis du texte, et ne pas le lire avec des préjugés ou des idées reçues, sinon on ne le comprendra pas facilement. C’est le texte qui donne ses propres axes de compréhension et non des idées déjà arrêtées dans nos têtes. En lisant le texte, l'élève peut souligner les mots clés et les idées phares avec son crayon.
2- La recherche du thème, du problème et de la thèse de l'auteur
a. Le thème
Le thème est l'idée générale du texte. C’est ce sur quoi le texte est centré. Pour le trouver, on pose la question : De quoi parle le texte ? Sur quoi est centré le texte ? Un texte peut parler de la philosophie, du sous-développement, de l'art, de la science, de l'ethnophilosophie. Chaque texte a son thème sur quoi la réflexion de l'auteur est centrée.
b- Le problème
Le problème est la question centrale du texte. Le texte est le point de vue ou la réponse de l'auteur à un problème. Le problème est donc la manière dont le thème est orienté dans le texte. Il se donne de manière déclarative. Le problème peut par exemple être : La définition de la philosophie, le rôle du philosophe dans la société, le rapport entre la philosophie et la science... Pour trouver chaque partie, l'élève n'hésitera pas à relire plusieurs fois le texte. Il ne doit pas se précipiter. Il a trois heures pour l'épreuve de philosophie s'il est en classe de Première littéraire et quatre heures s'il est en Terminale littéraire. Il doit donc prendre son temps pour lire plusieurs fois le texte avant de trouver un élément. Si je dis que Eto'o ne sait pas jouer au football, et que Mayanni dit qu’il est le meilleur joueur du monde, Mayanni et moi réagissons à un problème posé. Et ce problème est la performance d'Eto'o. En disant qu’Eto'o ne sais pas jouer au football, je donne mon point de vue (ma thèse) sur le problème de sa performance. Quand Mayanni dit qu'il est le meilleur joueur du monde, elle donne sa part de thèse sur le même problème.
c- La thèse
La thèse est le point de vue de l'auteur sur le problème. C’est ce qu'il pense, c'est sa réponse. Elle peut être explicite (formulée clairement) ou implicite (ne pas être formulée clairement). Parfois une phrase dans le texte ou une partie de la phrase du texte est la thèse de l'auteur. Au cas où son point de vue est implicite, il revient à l'élève de le formuler, de manière à rester le plus proche possible de sa pensée. Au problème du rôle du philosophe et de la philosophie dans la société par exemple, Njoh Mouelle écrit : « C’est en effet le rôle de la philosophie et des philosophes de veiller constamment pour pouvoir révéler aux autres le sens du présent et la direction de l'avenir. » Ceci est son point de vue sur le problème, et il est explicite. Il est dit clairement. Une autre personne pouvait dire que le philosophe est l'ennemi du progrès social. Cela allait être sa part de point de vue, sa part de thèse.
3- La recherche des éléments de l'examen analytique. (Structure logique)
a- Le postulat
Beaucoup d'enseignants préfèrent ne pas parler du postulat. Très peu d’enseignants d’ailleurs parlent du postulat. Donc si l’enseignant ne parle pas du postulat, il n’y a pas de soucis. A la place du postulat, beaucoup d’enseignants mettent la thèse de l'auteur. Le postulat est en fait ce que l'auteur veut démontrer en écrivant son texte. Le postulat est l’idée première, l'idée qui n'a pas encore été vérifiée et que le texte vise à vérifier. Le postulat d'un texte par exemple peut être que le philosophe est utile à la société. Donc c'est l'idée que l'auteur veut démontrer, et son texte vise à confirmer. Le postulat est comme une idée à vérifier, le but que visait l’auteur en écrivant le texte.
b- les arguments
Il s'agit ici des articulations du texte. L’élève doit faire un découpage du texte et trouver ses différentes parties. La nouvelle méthodologie stipule que le texte d'examen n’excède pas 16 lignes. Il serait donc difficile pour l’auteur de développer trois arguments en 16 lignes. La plupart de temps, le texte a donc deux arguments. L'argument est ce sur quoi une personne s'appuie pour défendre son idée. Si je soutiens la thèse selon laquelle la philosophie est inutile a la société, je peux m'appuyer sur son caractère théorique. Ce caractère théorique est l'argument que j'utilise pour défendre mon point de vue. De même, quand l'auteur du texte donne sa thèse ou quand son postulat est connu, il utilise des arguments pour défendre cette thèse. L’élève doit donc lire le texte et repérer ces arguments.
Il peut faire un découpage linéaire en délimitant son texte (de telle ligne à telle ligne il développe telle idée. Cette idée est l'argument). Mais tous les textes n'offrent pas cette facilité. Dans certains textes, les idées s'entremêlent. Dans ce cas l'élève fait un découpage thématique en fonction du thème et de la thèse). Il recherche les idées secondaires du texte qui constituent ses arguments. Tout texte philosophique a des arguments, puisqu'on soutient une thèse. Le commentaire de texte philosophique. On confirme ou on infirme, et on soutient toujours par des arguments.
c- La conclusion de la partie
Il ne s'agit pas ici de la conclusion du devoir, mais de la conclusion de l’examen analytique. La conclusion est le fait de résumer la pensée de l'auteur en une phrase. Généralement, la dernière phrase du texte résume tout le texte. Mais si la dernière phrase ne résume pas le texte, l'élève doit résumer le texte en une phrase.
4- La recherche des éléments de la réfutation
Ici, l'élève doit être capable de critiquer le texte de l'auteur, de trouver des limites à la pensée de l'auteur. Ce qu’on attend plus de l'élève c'est qu'il puisse critiquer la thèse de l'auteur. S’il ne peut pas critiquer la thèse de l’auteur, il critique n'importe quel argument du texte. S’il ne parvient toujours pas, il critique n'importe quelle partie ou phrase du texte. Il n'est pas question ici de critiquer les fautes dans le texte. La critique doit suivre une méthode. Il doit y avoir une idée, et l'argument pour défendre cette idée. L'élève peut trouver des incohérences dans le texte. Il peut, ce qui est très recommandé, utiliser un autre philosophe qui pense différemment que l'auteur du texte pour critiquer le texte. Cette méthode montre au correcteur que l'élève a une grande culture philosophique. L'élève n'a pas besoin d'utiliser les citations pour soutenir sa critique, Mais s'il peut le faire, ce serait un plus. Si à l'examen analytique l'élève est esclave du texte (il ne sort pas du texte), à la réfutation et à la réinterprétation, il peut sortir du texte. Pour mieux contredire l'auteur, il faut chercher l'antithèse. A quelle thèse l’auteur s'oppose- t-il ? Ou du moins quel point de vue contredit celui de l'auteur du texte ? On cherche les objections à la thèse de l'auteur, en montrant qu'il y a une antithèse qu'on peut soutenir par des arguments valables. Ici, l'élève fait appel à sa culture philosophique.
5-
La recherche des éléments de la Réinterprétation
du texte
Réinterpréter le texte c'est lui redonner sa valeur. A la réfutation, on a en quelque sorte déconstruit le texte. On a donné ses limites. A la réinterprétation, on doit montrer que malgré ces limites, le texte garde de l'intérêt. Il s'agit donc de trouver les intérêts du texte, ce qu'on peut gagner en lisant ce texte, ce que le texte peut nous apporter. L'intérêt peut être philosophique si le texte enseigne sur une notion philosophique, révèle des thèses contradictoires sur une thématique... L'intérêt peut être social si le texte peut contribuer à l'harmonie sociale, à l'entente entre les diverses composantes de la société... L'intérêt peut être culturel s’il permet de défendre la culture, de la repenser ou de mieux la comprendre et la véhiculer... L'intérêt peut être historique si le texte enseigne sur une partie de l'histoire. Bref, l'élève doit chercher ce qu'on peut gagner en lisant le texte.
II- L’introduction du commentaire de texte philosophique
Elle a quatre parties : La situation du texte, la formulation du thème et du problème, la formulation de la thèse de l'auteur et la problématique.
Il faut préciser que les points de vue divergent sur la thèse à l'introduction. Pour certains enseignants, on ne devrait pas préciser la thèse à l'introduction, mais à l’examen analytique, à la place du postulat. Mais pour nous, la thèse a sa place à l’introduction.
1- La situation du texte
Il s'agit ici de donner la source du texte, de préciser l'œuvre d'où le texte est tiré. Si possible, on peut situer le texte dans son contexte. Il s'agit de préciser les éléments dans l'œuvre qui précèdent le texte à commenter et qui ont une influence sur le ce dernier. On précise le thème central de l'œuvre (Mais ceci concerne plus la première A4. La Terminale A4 est tenue par le nombre de lignes, puisque tout son commentaire ne doit pas excéder vingt et cinq lignes. Les élèves ont donc l'obligation de précision et de concision. Ils doivent survoler les détails). La présentation de l'auteur fait aussi partir de la situation du texte. Les élèves de la Première A4 peuvent parler de ses œuvres, de sa biographie, et de plus de détails. Mais les élèves de Terminale peuvent juste préciser son nom ou de sa nationalité. Cela sera suffisant.
2- La formulation du thème et du problème
L'élève précise ici le thème central du texte. Il ne s'agit plus de celui de l'œuvre, mais de celui du texte à commenter. Après le thème, l'élève dégage le problème philosophique du sujet. Pour trouver le problème, on peut se demander quel problème avait l'auteur ? Quelle difficulté voulait-il résoudre?
3- La formulation de la thèse de l'auteur.
L’élève précise ici le point de vue de l'auteur par rapport au problème philosophique. L’auteur peut énoncer une thèse contraire à la sienne pour mieux faire ressortir l'invalidité de cette thèse. Ne confondez donc pas la thèse contre laquelle il se positionne à la sienne.
4- La problématique
La problématique est un ensemble de questions qui tournent autour du problème pour l'éclairer. Ce qui est important de savoir est que la problématique remplace l'annonce du plan. Elle est donc une annonce du plan. Elle annonce ce que l'élève fera au développement. En lisant la problématique, l'enseignant sait exactement ce que l'élève fera dans son corps du devoir. Elle doit donc contenir les parties du devoir. Rappelons qu'en lisant l'introduction et la conclusion, un enseignent peut ne pas lire le corps du devoir, mais savoir globalement ce que l’élève y a fait.
Il y a plusieurs manières de poser la problématique. Certains enseignants préfèrent deux questions qui résument toutes les parties du devoir. La première question énonçant l'examen analytique et son opposé la réfutation, et la seconde question centrée sur la réinterprétation. D'autres enseignants préfèrent une question qui résume les trois parties. D’autres enseignants encore préfèrent ne pas poser la question de la réinterprétation. C’est une question d’école. Pour nous, l’élève peut poser trois questions, une question pour chaque partie du devoir.
Voici deux exemples d'introduction, une pour la classe de Première A4 et l'autre pour la classe de Terminale A4.
a- Introduction de la Terminale A4
Tiré de l'œuvre De la médiocrité à l'excellence rédigée par le philosophe Njoh Mouelle, notre texte est centré sur la philosophie et les philosophes. Il soulève le problème du rôle de la philosophie et des philosophes dans la société. Pour Njoh Mouelle : « c'est en effet le rôle de la philosophie et des philosophes de veiller constamment pour pouvoir révéler aux autres le sens du présent et la direction de l'avenir ». Mais le philosophe n'est-il pas aussi inutile à la société?
Comme vous l'avez sûrement remarqué, nous avons posé une question au lieu de deux ou trois. Justement avec le nombre de lignes limité, il est conseillé de poser uniquement la question de la réfutation pour la Terminale A4.
b- Introduction de la Première A4
Le texte soumis à notre étude est tiré de l'œuvre De la médiocrité à l'excellence, qui explore les voies et moyens du développement de l'Afrique. Son auteur est Njoh Mouelle, un philosophe et politicien camerounais. Notre texte parle de la philosophie et des philosophes et soulève le problème du rôle de la philosophie et des philosophes dans la société. Njoh Mouelle soutient la thèse selon laquelle : « c'est en effet le rôle de la philosophie et des philosophes de veiller constamment pour pouvoir révéler aux autres le sens du présent et la direction de l'avenir ». Sur quoi se fonde Njoh Mouelle pour soutenir cette thèse ? Cependant, le philosophe ne peut-il pas être plutôt inutile à la société ? Que pouvons-nous tirer de ce texte de Njoh Mouelle?
III- Le développement
Il contient trois parties: L'examen analytique, la réfutation et la réinterprétation.
1- L’examen analytique
Il ne s'agit pas de paraphraser le texte (dire le texte en d’autres mots, et parfois même mal dire ce que l'auteur a pourtant bien dit.) Il s'agit de rendre de texte compréhensible, de faire une étude structurée du texte, de le disséquer pour faciliter sa compréhension. L'élève doit éviter les jugements de valeur du style : « L'auteur a raison quand il affirme ceci ».
L’examen analytique consiste à trouver comment l'auteur conduit son raisonnement, en partant du thème, du problème et de la thèse. Il doit montrer comment l’auteur défend sa thèse. Il doit donc chercher les arguments que l'auteur utilise pour soutenir sa thèse dans le texte, ainsi que les exemples qu'il utilise dans le texte pour soutenir ces arguments. L'élève peut citer les passages du texte dans le but bien sûr de soutenir une idée qu'il développe. Dans des cas extrêmement rares, certains textes peuvent ne pas avoir d'arguments. Il définit plutôt un concept ou plusieurs. Dans ce cas, il faut expliquer ces concepts, et montrer comment ils viennent appuyer la thèse de l'auteur. L'élève doit donc préciser le postulat, les arguments et exemples, ainsi que la conclusion. Il peut prendre les éléments hors du texte. Mais nous vous conseillons de rester esclaves du texte, de vous baser uniquement sur le texte pour travailler. En étudiant le texte, on essaie de se mettre à la place de l'auteur pour comprendre son raisonnement et la stratégie d'argumentation qu'il utilise pour soutenir sa thèse. Même si le texte se présente en un seul paragraphe, il possède toujours des idées différentes constituant les parties.
Voici quelques exemples d’examens analytiques
a- Exemple de la Première A4
Njoh Mouelle part de l’idée selon laquelle le philosophe est utile à la société (postulat). Pour prouver cette idée dans son texte, il montre dans une première partie le philosophe comme le veilleur de la société dans la mesure où sa voix doit être libératrice et libérer l’homme de ses chaines. L’auteur prend l’exemple de Karl Marx qui a révélé à la société les dangers du capitalisme et les conséquences que ces dangers peuvent engendrer (argument 1 et son exemple dans le texte). Dans une deuxième partie, l’auteur présente le philosophe comme l’oracle de la société, c’est-à-dire celui qui doit dire ce que doit être la société. Le philosophe camerounais insiste sur le fait que les révélations du philosophe relèvent de son jugement critique puisqu’ « aucun être mystérieux ne lui souffle ce qu’il doit dire » (argument 2). Njoh Mouelle conclut en précisant que le philosophe a le sens de l’humain (conclusion de l’examen analytique).
b- Exemple de la Terminale A4
Pour soutenir sa thèse, Njoh Mouelle montre dans une première partie le philosophe comme le veilleur de la société dans la mesure où il doit réveiller la société. Dans une seconde partie, l’auteur le montre comme chargé de guider sa société. Bref, le philosophe a le sens de l’humain.
Transitions
Pour passer d’une partie à une autre, il faut toujours la transition. La transition résume la première partie et annonce la suivante. Le commentaire de texte philosophique aura donc deux transitions : Une pour passer de l’examen analytique à la réfutation et une seconde pour passer de la réfutation à la réinterprétation. Deux écoles de pensées s’affrontent ici. Certains enseignants vous diront de faire la transition directement à la fin de la partie, d’autres vous diront d’aller à la ligne, et d’autres encore vous diront de sauter une ligne pour faire la transition. Pour la Terminale A4, il est préférable d’aller à la ligne pour faire la transition. Pour la Première A4, il est préférable de sauter une ligne, faire la transition, et sauter une autre ligne pour commencer la rédaction de la partie suivante. La première partie de la transition est donnée de manière déclarative, tandis que l'annonce de la seconde partie peut être soit interrogative, soit déclarative. La transition est courte.
Voici deux exemples de première transition.
a- Exemple de la Première A4
Bref, nous venons de voir avec Njoh Mouelle que le philosophe doit veiller pour révéler aux autres le sens du présent et la direction de l’avenir. Mais le philosophe ne peut-il pas aussi être inutile à la société ?
b- Exemple de la Terminale A4
En affirmant sa thèse, Njoh Mouelle ne semble-t-il pas oublier le fait que le philosophe peut aussi être inutile à la société ?
2- La réfutation
Ici, l'élève critique le point de vue de l'auteur. Il donne une idée et les arguments pour critiquer la thèse ou les arguments du texte. Il doit développer son argument pour soutenir sa critique et invalider celui de l'auteur ou apporter ses limites. Il doit donc expliquer, justifier sa critique, et montrer que cette critique est valable. La réfutation est comme l'antithèse de la dissertation philosophique. Réfuter n'est pas détruire le texte, mais donner ses limites. Il faut donc éviter les termes comme: « L’auteur a tort », «l’auteur ment », ou même « l’auteur se trompe ». Il est préférable d’utiliser les termes comme : «l’auteur semble perdre de vue le fait que… », «l’auteur n’a pas abordé tel aspect de la question », «l’auteur oublie le fait que …»
Voici deux exemples
a- Exemple de la Première A4
L’auteur dans ce texte n’a sûrement pas pris en compte le fait que le philosophe est aussi inutile à la société dans la mesure où il est théorique. En fait, le philosophe ne produit rien de concret, de visible, de palpable, contrairement au scientifique. Une mère dont l’enfant est mourant a besoin plutôt de la science et non du discours philosophique. Si le politique prend des décisions et les applique, le philosophe reste esclave des théories. Ce qui a poussé Clément Rosset à écrire : « Il ne faut pas compter sur le philosophe pour trouver des raisons de vivre. »
b- Exemple de la Terminale A4
L’auteur n’a sûrement pas pris en compte le fait que le philosophe est aussi inutile à la société dans la mesure où il est théorique. Il ne crée rien de concret, contrairement au scientifique. Il est resté esclave des théories.
Deuxième transition
Le texte de Njoh Mouelle a donc des limites, mais faut-il pour cela le rejeter ?
3- La réinterprétation
La réinterprétation souligne ce qui reste intéressant dans le texte malgré les critiques émises. Il s’agit des intérêts du texte. L’élève n’est pas obligé de préciser ces intérêts, mais juste de les développer. Si le texte a un intérêt didactique, l’élève n’est pas obligé de préciser qu’il s’agit d’un intérêt didactique. Voici des exemples de réinterprétation.
Exemple de réinterprétation pour la Première et la Terminale A4
Malgré les limites trouvées à ce texte, il est d’une importance capitale pour le développement de l’Afrique. En effet, au regard des multiples crises qui secouent l’Afrique et de la recherche des voies de son développement, le rôle du philosophe est très important. En tant que guide ou oracle, le philosophe doit guider le peuple africain vers le progrès. Le texte invite la société à avoir plus de respect envers le philosophe. Le texte enseigne l’histoire de la philosophie en revenant sur la contribution de Karl Marx à la lutte contre le capitalisme.
(Ce texte a donc un intérêt politique : sa contribution au développement de l’Afrique, et un intérêt historique : Il retrace une partie de l’histoire de la philosophie. Mais on peut développer ces intérêts sans les préciser.)
IV- La conclusion d’un commentaire de texte philosophique
Elle possède deux principales parties : Le rappel du problème philosophique du texte et le bilan. Comme son nom le précise, en première partie, l'élève doit rappeler le problème qui a fait l'objet de son commentaire. Il s'agit du problème philosophique que l'élève avait trouvé lors du travail préliminaire, et qu'il avait utilisé à l'introduction. Il rappelle ce problème à la conclusion.
Après le rappel du problème, il fait le bilan de son travail. Il précise la position de l'auteur par rapport à ce problème et les arguments qu'il a utilisé pour défendre sa thèse (examen analytique). Ensuite il rappelle la critique qui a été formulée à cette thèse ou au texte (réfutation). Enfin, l'élève rappelle ce qu'on peut gagner en lisant le texte (Réinterprétation).
Voici un exemple de conclusion.
Exemple de conclusion
Parvenus au terme de notre devoir qui portait sur le rôle de la philosophie et des philosophes dans la société, nous avons vu avec Njoh Mouelle que le philosophe veille constamment pour pouvoir révéler aux autres le sens du présent et la direction de l'avenir dans la mesure où il est le veilleur et l’oracle de la société. Cependant, nous avons aussi trouvé que le philosophe est inutile car il est théorique et non pratique. Ce texte de Njoh Mouelle nous a montré le rôle que le philosophe peut jouer dans le progrès de l’Afrique et nous interpelle à plus de respect envers le philosophe en société.
V- Présentation de la copie
Globalement, après l'introduction on saute deux lignes pour rédiger l'examen analytique. Apres, on saute une ligne pour rédiger la transition, et on saute une autre ligne pour rédiger la réfutation. Après la réfutation, on saute une autre ligne pour rédiger la deuxième transition, puis une autre ligne pour rédiger la réinterprétation. Après la réinterprétation on saute deux lignes pour rédiger la conclusion.
L'élève doit relire son devoir pour éviter les fautes. Faites attention aux accords. Aérez votre copie pour faciliter sa lecture, et soignez votre main d’écriture si elle n’est pas assez lisible. Dans la rédaction, il faut éviter les phrases longues. Construisez des phrases courtes et simples (Sujet-verbe- complément). N'utilisez pas les gros mots pour épater l'enseignant. Il n'est pas facile pour vous de l'épater. Il a au moins un diplôme de licence. En plus de ce diplôme de licence, beaucoup ont fait deux années et parfois plus dans les centres de formation. Ils ont presque tous fait plusieurs années dans l'enseignement, et plusieurs continuent de lire et faire des recherches. Utilisez de préférence un langage accessible et des mots que vous connaissez parfaitement la signification.
Assurez-vous que tous vos paragraphes aient le même alignement. Si vous décidez de laisser 1cm avant de commencer un paragraphe, il faut laisser le même espace sur commencer tous les paragraphes. Les paragraphes doivent donc être tous alignés.
Le plus important n'est pas la longueur du devoir. Le correcteur juge la valeur des arguments et le respect de la méthodologie du commentaire.
Vous aurez plus de détails dans notre site web www.ligueaa.org
Voici globalement ce qu’on attend de vous. N’oubliez pas d’aller dans le site web www.ligueaa.org. Vous pouvez intégrer un des groupes de préparation aux examens officiels de la LIMARA et de la Ligue Associative Africaine en envoyant votre numéro whatsapp au +237 674471831 ou au +237 696366502.
Pour ceux d’entre vous qui sont un peu mâtures et qui veulent fructifier leurs revenus, vous pouvez investir dans nos sociétés en contactant les mêmes numéros. Bonne chance pour vos examens.
Le succès se trouve au bout de l’effort