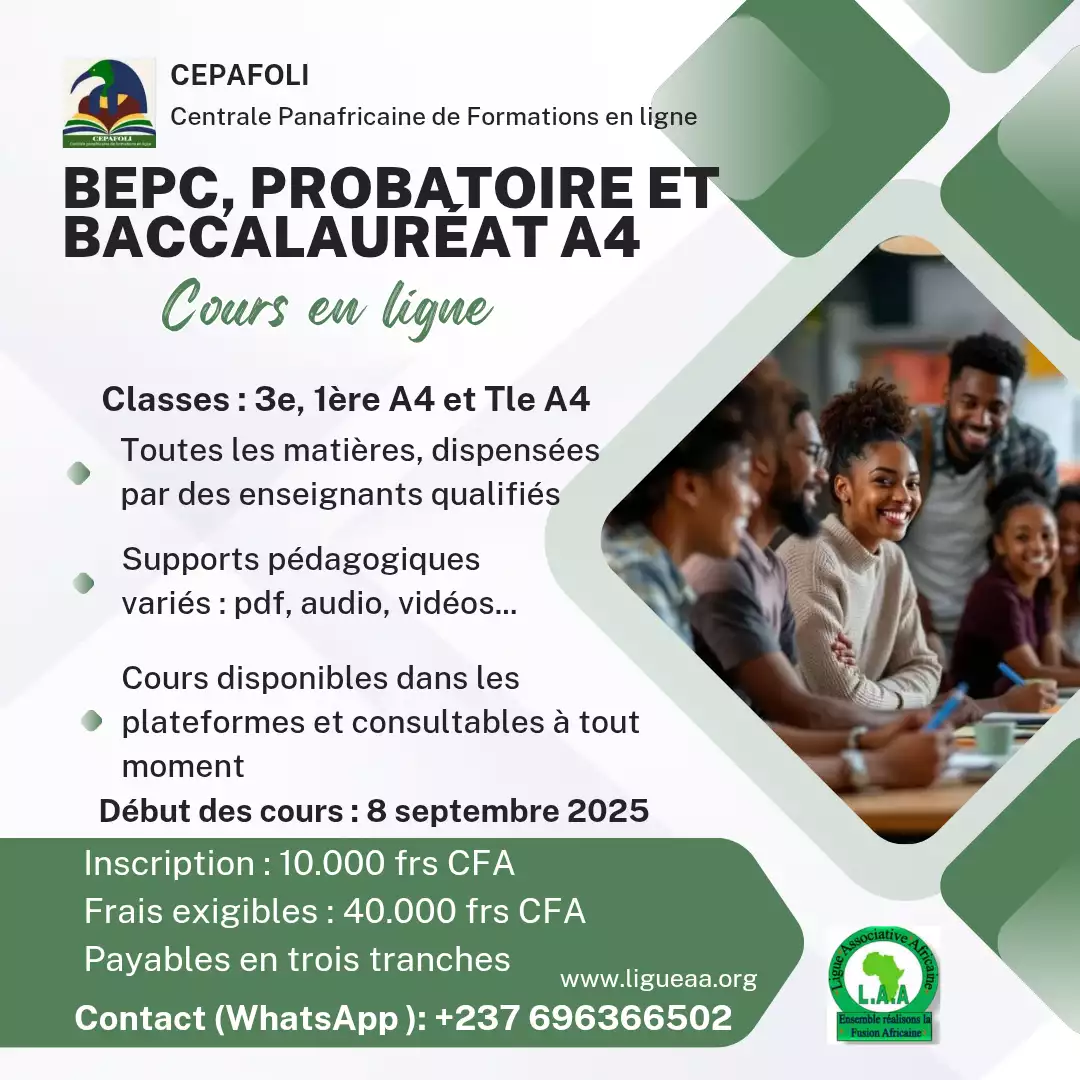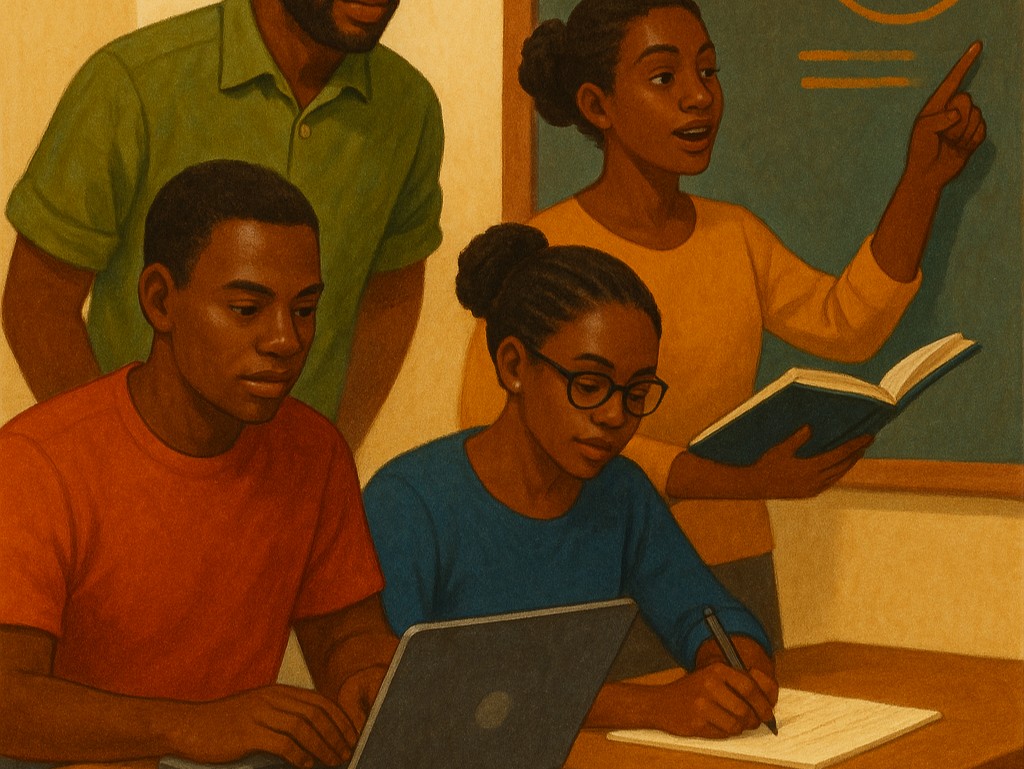La Grande Révolution Panafricaine et la chefferie traditionnelle
Nous dans la Ligue Associative Africaine sommes engagés dans la Grande Révolution Panafricaine, d’où sortira un État africain appelé République de Fusion Africaine. Cet Etat, uni et puissant, rendra au peuple africain son bonheur d’antan. Nous hisserons notre Nation au sommet des grandes puissances mondiales. Pour cette Grande Révolution, il faut que la chaîne impérialiste rompe quelque part. Cela peut être dans n'importe quel pays africain. Vu le degré de développement des forces et de la conscience continental, nous pensons que cette chaine va rompre au Cameroun. Ce n'est qu'une supposition. La République où la chaîne rompra le premier jouera le rôle de pionnier. Elle doit non seulement façonner une économie puissante mais aussi forger une armée puissante, capable de soutenir tous les autres pays africains et de mener la Grande Révolution Panafricaine. La Ligue Associative Africaine est l'organisation qui mène cette grande révolution. Nous soulevons ici un point très important de cette révolution : la place à donner à la chefferie traditionnelle. Pour mieux élucider ce fait, revenons sur la définition de 3 notions et levons l'équivoque. Il s'agit de la révolte, de la réforme et de la Révolution.
Beaucoup utilisent à tort le terme « Révolution » pour parfois qualifier de simples révoltes ou des réformes. Les trois notions sont des réactions à une situation difficile, comme celle que traverse actuellement l'Afrique. Le révolté se fâche et dit que cela doit cesser. Il ne propose rien pour changer la situation. Son « non » est catégorique. Il se lève souvent, marche, prend les armes pour lutter et renversent souvent les régimes. Au cas où une révolte renverse un régime, les révoltés déchantent rapidement. Rien n’a été prévu pour corriger la société qu'ils critiquaient. Le système capitaliste les lient et ils ne peuvent pas grand-chose. On parle de trahison, de confiscation de pouvoir. Les retombés de la révolte sont maigres.
Beaucoup disent que l'étape première de la Révolution et la révolte. Cette logique et fausse puisque la révolte et un « non » catégorique. Toutes les protestations ne sont pas des révoltes. La révolte est spontanée, elle n'est généralement pas préparée. Parfois, c'est quelques personnes qui, fatigués du système, lèvent des voix de colère et les autres les suivre dans cette colère. C'est le cas dans le printemps arabe, avec Bouazizi qui, fatigué de la situation de misère, s’est brulé vif. Ne supportant pas ce geste, le peuple a profité pour exprimer sa colère. La conséquence a été la chute de plusieurs régimes en Afrique du Nord. La révolte, dans certains cas très rares, peuvent même être planifiées. Toujours est-il, une autre société n’est pas pensée pour remplacer celle à laquelle on s’oppose.
La réforme est l’étape intermédiaire entre la révolte et la révolution. Le réformateur, devant une situation difficile, propose des solutions sans contester tout le système, sans remettre en question le système lui-même. Il se contente de résoudre les problèmes sociaux et lance les grands chantiers. Il se contente de construire sur l’ancienne fondation, en oubliant que le problème c’est la fondation elle-même. Quand il prend le pouvoir, il y a une période de bonheur et un semblant de prospérité. Il réussit souvent à absorber la main d’œuvre en chômage, à moderniser l'agriculture, l'armée, la science et autres secteurs. La réforme est de très loin préférable à la révolte, mais très inférieure à la révolution qui est la solution suprême. Les résultats de la réforme sont de courte durée puisque le système le rattrape toujours. La réforme et comme un malade souffrant de paludisme qui se manifeste par les maux de tête et la fièvre. Le réformateur se contente de soigner les maux de tête et la fièvre qui ne sont que des symptômes de la maladie. Pendant des jours, voire des mois, le malade sera à l'aise. Il jouera au football, ira au travail… Mais ce bonheur sera de courte durée puisque le germe du paludisme n'a pas été détruit. Il rechutera, et cette fois il risque de laisser la vie puisque le germe du paludisme a pris le temps pour s’adapter. Il est devenu plus fort. Nous pouvons aussi prendre l'exemple d'une voiture rouillée. Les révoltés s'opposent au fait que la voiture soit rouillée et ne proposent rien. Le réformateur applique une couche de peinture sur rouille. La voiture brille. Elle parait neuve. Pour beaucoup, le problème a été résolu puisqu’on ne voit plus la rouille. Mais à l'intérieur de la couche de peinture, la rouille continue de détruire la voiture. L’éclat de la voiture sera de courte durée, et le réformateur sera obligé de constater la faiblesse de sa politique.
La révolution est aussi une réaction à une situation difficile. Mais son « non » n'est pas catégorique. Sa négation et suivie d'une nouvelle affirmation. La révolution est la plus difficile à Mener. C'est pourquoi plusieurs organisations l'esquivent. Devant une situation difficile comme celle de l'Afrique présentement, le révolutionnaire prend du temps, étudie les causes de la situation, étudie les facteurs qui se conjuguent pour maintenir l'Afrique dans la situation actuelle, étudie les forces qui les résistent, qu’elles soient éparses ou plus convergentes. Il étudie les rapports entre les forces du changement et celles du statut quo. Quand il a fait ce travail de compréhension de la situation, il théorise une nouvelle société plus juste. C'est la tâche fondamentale de la révolution. En Afrique présentement, seule Afrocentricity International et nous faisons ce travail. D’ailleurs, la principale faiblesse de presque tous les mouvements révolutionnaires africains depuis plus de 400 ans a été le manque de théorisation de leur lutte. Ils étaient obligés d’axer leur lutte sur les théories étrangères souvent en très grand déphasage avec leurs réalités. Quand on veut faire une étude théorique des révolutions africaines depuis plus de 400 ans, on se confronte à une sérieuse difficulté. Il y a urgence de théoriser notre lutte. La théorisation est l’élément capital de la révolution. Les révolutions non théorisées sont très vite balayées : burkinabè, camerounaise, égyptienne… Les révolutions sérieuses sont théorisées à l'avance. Après avoir théorisé une nouvelle société, le révolutionnaire mobilise les forces pour la rendre possible. Ces forces qu'il mobilise doivent être formées pour être à la hauteur de la Révolution. Frantz Fanon définit la décolonisation comme le remplacement d'un type d'homme par un autre type d'homme. Le nouveau type d'homme n'apparaît pas comme un zombie. Il doit être formé. C’est ce qui justifie l’école des cadres de notre parti politique la LIMARA et les études panafricaines de la Ligue Associative Africaine. La révolution s’attaque à tout un système, pas seulement à ses aspects. Dans la révolution, si on emprunte la logique de Frantz Fanon, ce n'est pas seulement la mort de l'oppresseur qui est souhaitée, mais aussi celle de l'opprimé. Dans la révolution, l’opprimé se réinvente, il se recrée. Il sort de la Révolution avec une nouvelle identité. En même temps qu’il conteste les éléments de l'oppression étrangère, en même temps il se remet lui-même en question et rejette certains éléments de sa propre culture.
La révolution africaine comme le pense beaucoup d'Africains, n'est pas et ne sera jamais le retour à la culture africaine précoloniale, ou avant le contact avec l’Europe. Elle est le façonnement une nouvelle culture, que nous aurons décidée. Cette culture doit prendre appui, doit avoir pour socle la civilisation égypto-nubienne, sans prétendre reconstituer intégralement au 21e siècle une civilisation vieille de plus de 17000 ans.
L’un des éléments fondamentaux qu'il faudra opérer pendant la Révolution est le démantèlement de la chefferie traditionnelle, ce qui conduit sans aucun doute à la séparation entre le pouvoir politique est le pouvoir religieux, qui est déjà en soit une révolution. Le chef traditionnel est chef religieux. Il est le représentant de Dieu dans la communauté. Il est garant de la stabilité sociale. Il a le pouvoir de communiquer directement avec les ancêtres. Bref, il a deux fonctions : une fonction administrative et une fonction religieuse.
Pendant la colonisation, la chefferie a été au service du colon qui l’a utilisé pour s’imposer, mater le peuple, collecter les impôts. Le chef n'était plus le garant de du bien-être du peuple, mais son bureau. Il a émergé des chefs Sanguinaires et oppresseurs. Cette logique n'a pas été détruite après l'indépendance. La chefferie traditionnelle a donc basculé du côté de l’ennemi. Une révolution qui prétend libérer un peuple ne peut laisser intact un élément puissant de son oppression. Pendant la colonisation, les colons ont exacerbé le tribalisme en s’appuyant grandement sur la chefferie traditionnelle. Cette logique perdure jusqu’à présent. Le chef traditionnel estime être le chef de sa communauté, au moment où nous sommes dans la République. On entend souvent les chefs traditionnels parler d’étrangers pour désigner ceux qui ne sont pas de leurs communautés. La chefferie traditionnelle est donc vectrice de division sociale alors que la révolution vise la cohésion sociale, l’unité. La chefferie reste attachée aux aspects culturels des communautés et est jaloux de ces aspects au moment où il faut forger une culture continental propre, unifier les aspects culturels éparses pour façonner une véritable culture continentale capable de résister victorieusement aux assauts des cultures occidentales et orientales. Ceci est aussi valable pour la religion. Il faut une unité religieuse qui se construit et se développe indépendamment des chefferies traditionnelles ou des communautés. Elle doit disposer de ses temples, de ses officiants, bref de tout son système. Cette religion c’est l’Amonisme.
Le caractère héréditaire de la chefferie traditionnelle est l'un des aspects de son démantèlement. Les compétences ne se transmettent pas de père en fils. Tous les citoyens doivent avoir les mêmes droits d’administrer une partie du pays, qu'ils soient de la zone à administrer ou pas. C'est cela qu'on appelle révolution : le changement brusque et radical d'une société. Une révolution en Afrique qui ne prend pas en compte la chefferie traditionnelle et son impact nuisible sur le changement aura de sérieuses difficultés. Il faut désormais une durée déterminée pour le chef traditionnel. On ne peut pas opérer un changement aussi profond en maintenant intact les éléments d’oppression et de division. Ce qui est valable pour la chefferie traditionnelle l’est également pour la chefferie musulmane.
Bien évidemment on ne peut pas dès le début de la Révolution s'attaquer à se fait. Si la résistance est très forte lors du démantèlement de la chefferie traditionnelle, il faut lui retirer tout pouvoir et créer une administration parallèle à côté d'elle et doté de tous les pouvoirs. Dans cette logique, la chefferie traditionnelle devra se désintégrer seule. Pour les chefferies qui acceptent ce processus révolutionnaire, l’Etat devra sérieusement les appuyer.
Le démantèlement de la chefferie traditionnelle sera un grand pas vers notre unité, et consolidera une culture africaine pure, authentique, capable de résister contre les assauts des cultures étrangères.