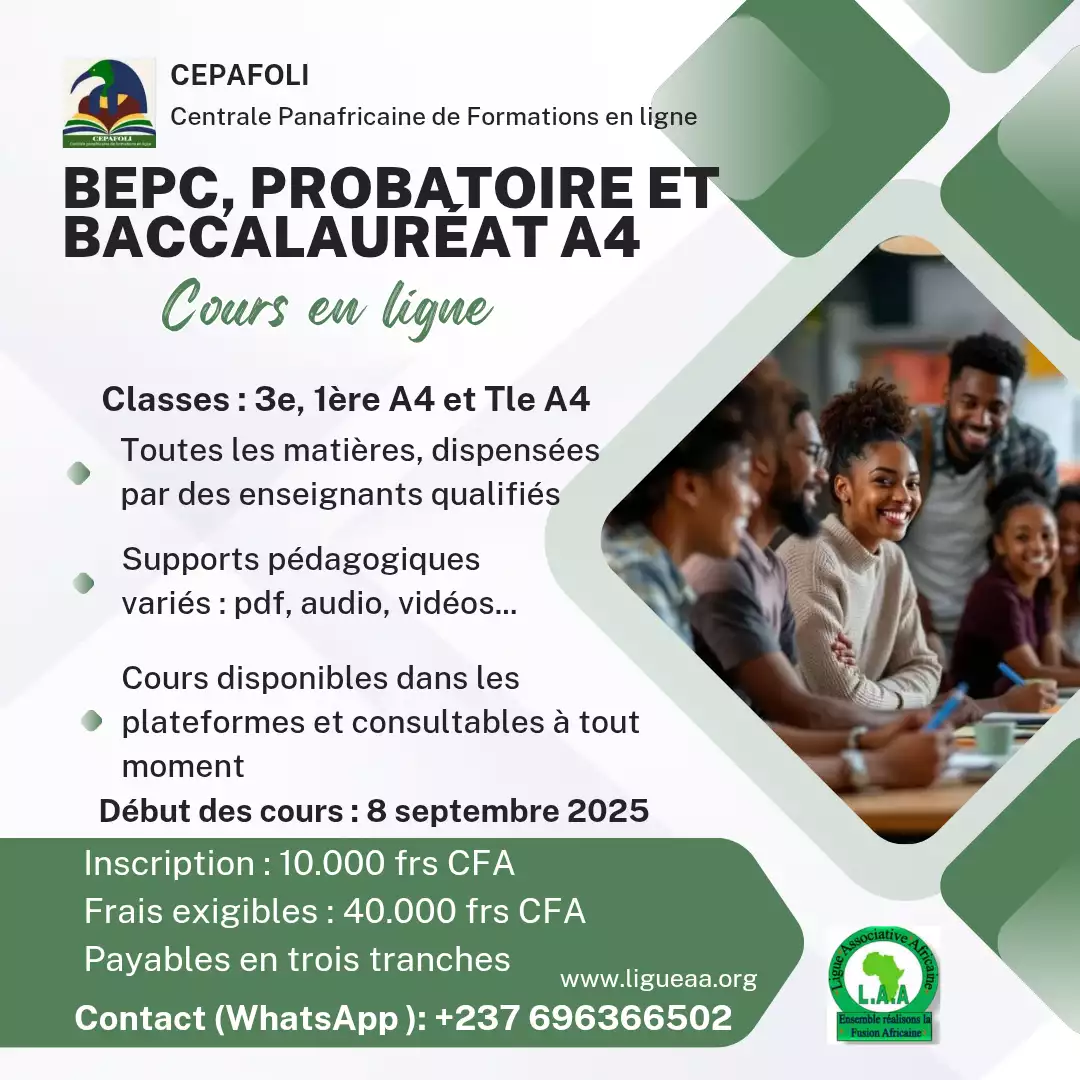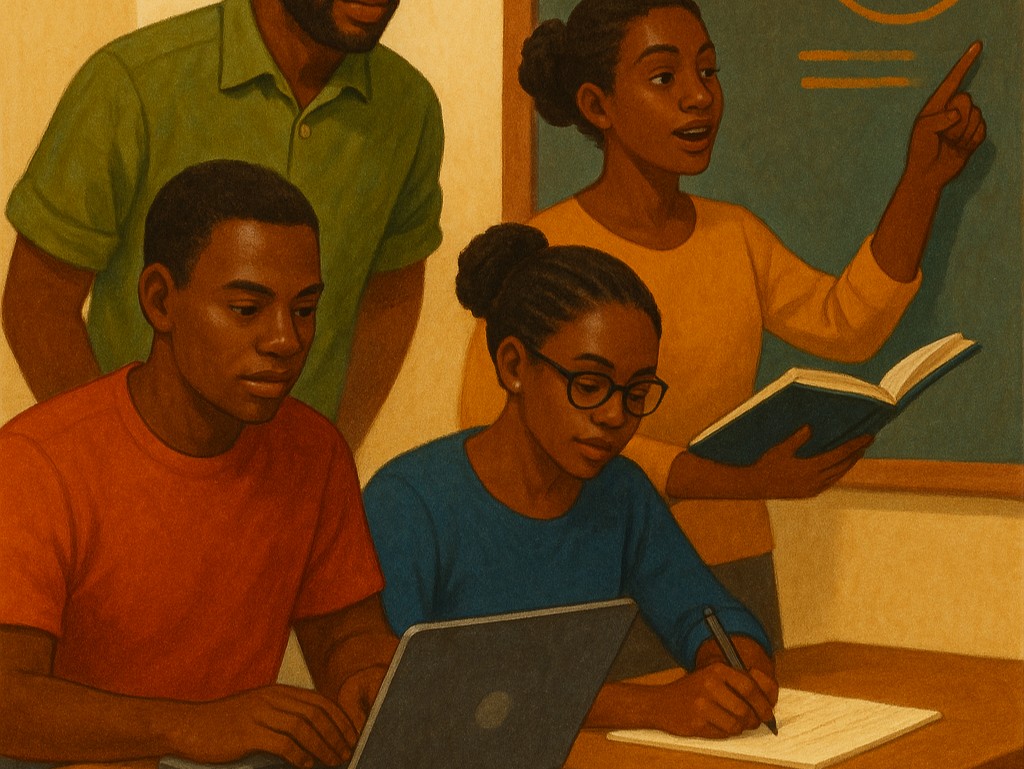AMÉNAGEMENT URBAIN ET HYGIÈNE PUBLIQUE DANS LES AGGLOMÉRATIONS DU TERRITOIRE CAMEROUN SOUS L’ADMINISTRATION MANDATAIRE DE LA FRANCE : CAS DE DOUALA
Résumé :
La réflexion à laquelle nous invitons le lecteur pose le problème de l’aménagement des espaces urbains à l’époque coloniale, dans un contexte marqué par la permanence des endémo-épidémies. L’urbanisme colonial a été largement influencé par les questions de santé publique. Pour arriver à cette constatation, nous avons privilégié l’étude documentaire, puisqu’il ne nous est pas possible, vue la période concernée, de faire une enquête transversale. En somme, il en ressort que l’urbanisme colonial obéit à un ensemble de représentations idéologiques posant l’indigène comme étant un réservoir de maladie. Cette perception a largement influencé le paysage urbain de la ville de Douala.
Mots clés : Aménagement, Endémo-épidémie, Urbanisme colonial, Ségrégation urbaine.
Abstract:
The consideration to which we invite the reader depicts the problem of the arrangement of urban areas during the colonial period, within a context characterized by the permanence of endemic-epidemic diseases. Colonial urbanism was largely influenced by the consideration of public health issues. In order to reach such statement, we have given preference to desk research, since it is impossible, due to the period concerned, to do a cross investigation. As a summing up, colonial urbanism follows a set of ideological representations which see the native as being a tank full of diseases. This perception has highly influenced Douala’s urban landscape.
Key words: Arrangement, Endemic-epidemic disease, Colonial urbanism, Urban segregation.
Introduction
Douala, ville d’estuaire bâtie sur un bassin sédimentaire du même nom, est remarquable par sa faible altitude et ses grandes trouées correspondant aux estuaires du Wouri, de la Sanaga et du Nyong. Ces estuaires sont disséqués en une multitude de criques avec des rebords recouverts de mangrove. Il s’agit d’une ville construite sur des terres marécageuses, donc insalubres, ce qui a nécessité un aménagement approprié. Le problème qui se pose ici est celui de la logique et des représentations qui ont sous-tendues l’aménagement des espaces à l’intérieur du périmètre urbain défini par la puissance mandataire française, et comment ces représentations ont influencé l’occupation du sol. Notre hypothèse de travail est que le paysage de la ville de Douala sous le mandat français est une construction qui répond aux multiples préoccupations hygiéniques des autorités, lesquelles préoccupations sont influencées par une projection mentale de l’image que le colon se fait de l’indigène. L’enjeu de cette recherche est de montrer que l’univers mental d’un groupe humain, ses préjugés et tabous, impactent sur le mode d’appropriation du sol dans l’espace urbain, dans un contexte multiracial et même multiethnique. L’objectif de cette recherche est de comprendre la logique qui préside à l’urbanisme colonial, de montrer comment cette logique influence l’occupation du sol dans le périmètre urbain, ainsi que ses conséquences. Après une présentation de la démarche méthodologique et des résultats de recherche, nous ouvrirons une discussion sur l’influence des questions hygiéniques dans l’aménagement des espaces urbains dans le contexte colonial.
- De la méthodologie de recherche
1.1. De la délimitation thématique
La problématique de l’organisation et de l’aménagement de l’espace à Douala date de la période précoloniale. Les populations de la côte s’étaient installées sur un site caractéristique :
« Trois plateaux riverains et sur la berge opposée du Wouri, une presqu’île. Dès le début du XIXe siècle, les écrits des commerçants navigateurs en font foi, ce groupement (Duala) avait déjà transformé, en se la partageant et en l’occupant intensément, la partie la plus accessible et la mieux exposée de l’estuaire. Entre les plateaux l’on communique et à l’intérieur des quartiers formés par chaque plateau un système de voirie existait. Les constructions étaient en outre alignées »[1].
C’est donc d’un ordre entretenu qu’hérite le colonisateur allemand. Cependant, les logiques qui président à l’organisation de l’espace que ce soit à l’époque précoloniale qu’à l’époque coloniale sont en total opposition. Au cours de la période coloniale, aux préoccupations écologiques, viennent s’associer un ensemble de représentations issues de l’imaginaire colonial. C’est au cours du mandat français que ces logiques et représentations vont le mieux s’exprimer : d’où l’importance de cette période pour comprendre le rapport aménagement urbain et hygiène publique dans l’univers colonial.
1.2. Méthode de recherche, traitement et analyse des données.
Pour aborder cette réflexion, nous nous sommes limités à l’étude documentaire vue l’époque et les matériaux que nous disposons. Conscients qu’un document est toujours à manier avec circonscription et intelligence avisée, nous avons procédé à une analyse qualitative de leur contenu en essayant chaque fois de dégager le contenu manifeste et latent. Pour minimiser nos risques de dérapages, nous nous sommes livrés à des entretiens libres avec quelques universitaires et chercheurs spécialistes de l’histoire coloniale.
2- Espace urbain de la ville de Douala sous le régime du mandat français
2.1- La politique d’aménagement
2.1.1- La ségrégation raciale dans l’espace urbain de Douala
Elle date de l’administration allemande qui la justifie en ces termes :
« La ségrégation raciale trouve son fondement dans l’importance et l’opposition de la race blanche vis-à-vis de la race noire. Cette politique doit, si l’on tient à ce point de vue, d’être encouragé sur le plan domanial afin d’éviter à temps ou au moins autant que possible, le danger dans lequel se sont jetés les Anglais sur la côte occidentale d’Afrique(Cf Lagos, Sierra-Leone, Calabar) et qui plane sur nous à Douala, danger dû au fait de l’institution et du développement de l’égalité sociale et politique avec les indigènes »[2].
Pour l’administration allemande, la proximité des cases indigènes des habitations des populations de race blanche cause un réel souci hygiénique et sanitaire. Les cases indigènes à proximité des quartiers européens, construites en matériaux locaux, entourées de petites clôtures et comportant puits et trous d’aisances sont des foyers de moustiques porteurs de paludisme[3]. Cette incommodité pousse le médecin Ziemann dans un rapport en date du 28 mai 1910 à suggérer le déplacement des villages indigènes a une distance de 1 km des habitations européennes, distance correspondant au rayon d’action du moustique : d’où l’idée d’exproprier les indigènes dont les cases sont bâties à proximité des quartiers européens. La décision d’exproprier la population indigène du plateau Joss, devenu du fait de la forte concentration de la population blanche un quartier européen, est motivée par des analyses faites sur 1635 sujets, enfants, adultes et adolescents et qui ont révélé que 72,2 sont contaminés et que dans certains quartiers du plateau, on a obtenu des maxima de 91 de contaminés. Du point de vue allemand, l’indigène est un réservoir de maladie et sa proximité avec une population européenne représente un risque sanitaire[4].
L’espace de 1 km qui sépare la ville européenne des quartiers indigènes est de ce fait un cordon sanitaire pour protéger la population européenne du territoire. Cette logique reste la même au cours du mandat français : «Par la destruction des moustiques, par le drainage des zones marécageuses par la réalisation complète du plan de ségrégation, un Européen pourra vivre à Douala avec un minimum de chances d’infection»[5].
Au cours du mandat français, la ségrégation raciale urbaine comme politique d’aménagement de l’espace urbain est renforcée par un ensemble de textes juridiques dont le plus expressif nous semble l’arrêté du 1er octobre 1937 fixant les règles générales d’hygiène et de salubrité publique à appliquer dans le territoire. Son article 1er stipule que : « Dans tous les centres urbains de nouvelles formations, et partout où cette mesure pourra être appliquée, il sera prévu entre les quartiers européens et indigènes, une zone non bâtie et débroussée de 800 m au minimum… »[6].
Le danger que représente la population indigène de Douala se justifie aussi par sa mobilité. En effet, vivant le plus de l’agriculture, la population indigène de Douala se déplace fréquemment dans les fermes situées à 25 km et parfois 40 km de la ville, en pleine zone palustre. Elle y réside parfois entre trois ou six mois, le temps des cultures. De retour a Douala après un long séjour en zone palustre, cette population indigène est vue comme un réservoir intarissable d’hématozoaires[7]. Cette migration temporaire réduit les efforts de quininisation de cette population, entrepris par le service de santé. Il devient alors urgent de minimiser les contacts entre cette population indigène et la population européenne : d’ où la politique de ségrégation urbaine en tant que mesure de mise en quarantaine de l’élément sain en minorité dans un espace géographique à risque.
La législation en vigueur sur le territoire Cameroun sous-mandat français vient renforcer cette ségrégation en délimitant le périmètre urbain de la ville en deux zones :
« Art 53- l’intérieur du périmètre urbain administratif de Douala est divisé en deux zones en ce qui concerne les prescriptions, applicables aux constructions, à l’observation desquelles est subordonnée la délivrance des permis de bâtir. La première zone est délimitée, sur la rive gauche du Wouri, par la crique Kotoko, la rue de Verdun, une ligne idéale tracée à 100 mètres, parallèlement à l’avenue Cumberland et au nord-ouest, une ligne idéale est-ouest passant au croisement de l’avenue Cumberland et de la route du dépôt d’hydrocarbure, une ligne idéale joignant ce croisement au passage à niveau sis sur la route serpentine, la route serpentine jusqu'à la route de New-Bell, la route de New-Bell sur 100 mètres, la route perpendiculaire sur 200 mètres, une ligne idéale parallèlement à la route de New-Bell et située a 200 mètres jusqu'à la Bésèkè, la Bésèkè, la bessesukou puis une ligne idéale tracée a 50 mètres et parallèlement à l’avenue du président poincaré au nord-est et en fin le Mbopi jusqu’au Wouri. Sur la rive droite du Wouri la 1ere zone est limitée par une ligne idéale tracée à 50 mètres au sud et parallèlement à la voie principale du chemin de fer, puis une ligne idéale tracé a 50 mètres à l’ouest et parallèlement à la route du dispensaire. La 2eme zone est délimitée par la limite de la 1ere zone ci-dessus définie et la périphérie des quartiers de New-Bell, Deido, Bali, Akwa, et Bonaberi compris dans l’intérieur du périmètre urbain »[8].
Chaque zone urbaine est soumise à une réglementation particulière pour ce qui est de l’organisation et de l’aménagement de l’espace.
2.1.2- L’aménagement de l’espace dans les zones urbaines de la ville de Douala.
L’arrêté n° 371 fixant les règles générales d’hygiène et de salubrité publique à appliquer dans le territoire ne vient que renforcer les mesures de protection de la santé publique, édictées par l’arrêté du 10 mai 1922, fixant le périmètre du centre urbain de Douala[9]. Et l’arrêté du 23 mai 1928 rendant permanente certaines mesures d’hygiène nécessaires à la protection de la santé publique : le permis de bâtir par exemple est délivré par le chef de région sur avis favorable du chef du bureau d’hygiène qui se rassure que le modèle d’habitation projeté en construction répond au modèle dit « hygiénique ». La demande de permis de bâtir est un dossier en double exemplaire transmis au service d’arrondissement des travaux publics et au service d’hygiène. L’exemplaire du service d’hygiène est destiné à la constitution du dossier sanitaire après examen des normes sanitaires. L’approbation du chef du service d’hygiène est nécessaire pour l’acquisition du permis de bâtir.
Le dossier pour l’obtention du permis de bâtir est constitué des dessins côtés de la construction projetée et de ses dépendances, un plan en situation au 1:500eme faisant ressortir l’emplacement par rapport aux constructions et terrains limitrophes et l’orientation, des dessins cotés faisant ressortir la situation respective des diverses canalisations servant d’une part à l’adduction d’eau potable et d’autres part à l’évacuation des eaux usées un plan détaillé de la fosse septique dans le cas où le tout à l’égout ne peut être réalisé, les caractéristiques détaillées de l’aménagement anti-rat…
L’examen de ce dossier technique nous permet de constater un souci hygiénique en édictant un minimum de règles à observer pour l’obtention du permis de bâtir. De plus, l’implication du service d’hygiène dans la procédure administrative de l’obtention du permis de bâtir montre l’importance que l’administration coloniale accorde aux questions de santé. Pour les habitations en matériaux définitifs, la législation en vigueur en 1937 prévoit au moins un cabinet d’aisance installé dans un local éclairé et aéré. Dans les établissements à usage collectif, un ou plusieurs cabinets sont à prévoir pour les européens suivant le ratio de un cabinet d’aisance pour cinq pièces habitables. Pour les habitations en matériaux temporaires, une fosse d’aisance du modèle approuvé par le service d’hygiène est obligatoire. Elle doit être à l’extérieur de l’habitation[10].
Dans la zone urbaine n° I, aucune habitation ou dépendance en matériaux provisoires n’est tolérée. La démolition de celles qui existent et qui ne répondent pas aux exigences de l’hygiène est ordonnée par le chef de région :
« … les constructions en bois et de type indigène présentant des dangers pour la santé publique peuvent être démolies après avis du médecin-chef du service d’hygiène dans les conditions prévues par le décret susvisé du 3 Avril 1935 (Article 5) »[11].
Le sol de toute maison d’habitation doit être au minimum à 0,60 centimètres[12]au-dessus du niveau de la cour et de la rue[13] :
« …La maison sera pourvue d’une ou plusieurs vérandas, aménagées de façon à protéger les pièces d’habitation des atteintes trop vives du soleil. La hauteur des pièces sous plafond ne sera pas inférieure à 3m50[14]. La profondeur des pièces habitées ne pourra pas dépasser le double de la hauteur, sauf pour les pièces à usage collectif, telles que salles de réunion, d’écoles etc.… » [15].
Les dispositions quant à l’hygiène des entrepôts, des hangars, des boutiques permettent de renforcer les mesures de prophylaxie anti-pesteuse dans les deux centres urbains de la ville de Douala. A cet effet, l’aménagement anti-rat prévoit :
«Un sol en béton d’une épaisseur de 6 cm, portes munies d’un mécanisme automatique de fermeture et doublées à leur partie inférieure d’une feuille de zinc de même que leur huisserie. Une traverse de fer sera scellée dans le seuil. Ces locaux auront, à une hauteur de 60 cm au-dessus du sol, une corniche débordant de 20 centimètres et à concavité inferieur »[16].
Toutes ces mesures n’auraient pu avoir une incidence dans la protection de la santé publique, si les questions d’hygiène publique n’étaient pas au cœur des préoccupations des autorités coloniales françaises.
2.2- L’hygiène publique dans la ville de Douala
2.2.1- Des services d’hygiène à l’Institut d’Hygiène : 1916-1932.
L’arrêté du 1er décembre 1916 institue un service d’hygiène dans « les centres européens et dans les escales des territoires occupés de l’ancien Cameroun. A Douala, ce service d’hygiène est assuré par 20 manœuvres et 5 chefs d’équipe. A Kribi, le service d’hygiène est assuré par quatre manœuvres et un chef d’équipe. Dans les autres centres européens, le médecin de circonscription est chargé du service d’hygiène et de la surveillance des mesures d’assainissement concernant la destruction des mouches, moustiques, et rats etc.... Il a sous ses ordres comme agents, les infirmiers européens ou indigènes en service dans le poste »[17]
Le 2 décembre 1916, un second arrêté vient instituer des commissions d’assistance sanitaire et d’hygiène publique dans les circonscriptions du territoire. Ces commissions sont chargées de l’examen de toutes les questions sanitaires intéressant l’hygiène dans la circonscription[18].
L’article 7 de cet arrêté donne la composition de ces commissions d’hygiène :
« … -Du commandant de circonscription, Président.
-Du médecin de la circonscription, Membre
-D’un officier ou fonctionnaire, Membre.
-D’un notable indigène, Membre ».
Les commissions d’hygiène dans les circonscriptions centralisent les renseignements de la circonscription et contrôlent dans les villages l’exécution des ordres donnés. En cas d’indisponibilité ou d’absence du médecin elles se substituent à lui pour ordonner les premières mesures à prendre[19].
Dans son domaine de compétence, la commission d’assistance sanitaire est chargée de la surveillance de l’éclosion des épidémies et de les combattre. Elle veille à l’exécution des règlements sanitaires dans toute l’étendue de la circonscription et reçoit communication des cas de maladies transmissibles dont la liste est fixée par l’arrêté locale du 26 janvier 1917. Les commissions d’assistance sanitaire sont coordonnées dans leurs activités par un conseil supérieur d’hygiène et de salubrité publique dont le siège est à Douala.[20]
Ainsi organisée les commissions d’assistance sanitaire dans les circonscriptions concourent à la défense sanitaire du territoire. Le 20 septembres 1925, un arrêté local crée le bureau d’hygiène du territoire avec son siège à Douala et chargé de coordonner l’activité des commissions dans les circonscriptions. En 1931, le bureau d’hygiène est augmenté d’un service de prophylaxie des maladies sociales avec appareillage syphilimétrique. En 1932, le bureau d’hygiène devient l’Institut d’Hygiène.[21]
En cette même année, est publié un arrêté local réglementant l’organisation et le fonctionnement du service de santé au Cameroun[22]. Le service de santé du territoire assure les services de médecine sociale, de médecine préventive et d’hygiène[23]. Ses moyens sont classés en organismes du service central et en organismes du service de circonscription. Parmi les organismes du service central, on note : la direction du service de santé, l’institut d’hygiène et les bureaux d’hygiène, la pharmacie et les magasins d’approvisionnement, le service de prophylaxie de la maladie du sommeil[24].
Une première remarque s’impose : la réforme de 1932 fait remplacer les commissions d’assistance sanitaire par les bureaux d’hygiène avec les mêmes prérogatives. L’institut d’hygiène a dans son action, la prophylaxie des maladies épidémiques, l’hygiène sociale et l’hygiène de la ville de Douala[25]. Le personnel mis à la disposition du directeur de l’institut d’hygiène comprend : du personnel de laboratoire (médecin, bactériologistes et préparateurs indigènes), des brigades d’hygiène, du personnel d’hygiène sociale (Infirmières visiteuses…)[26].
L’institut d’hygiène dispose pour ses missions d’un ensemble d’instruments techniques tels que le laboratoire de bactériologie, le laboratoire de syphiligraphie, le laboratoire du BCG[27]…
2.2.2-Le problème de l’enlèvement des immondices dans les deux zones urbaines.
Ce n’est pas par défaut d’une réglementation que le problème se pose avec acuité. L’article 74 de l’arrêté n o 371 d’octobre 1937 stipule que :
« Le propriétaire ou locataire de tout immeuble habité de la zone n° I est tenu de faire déposer chaque matin, sur le trottoir près de la porte d’entrée, en un point parfaitement visible et accessible, une ou plusieurs poubelles métalliques munies d’un couvercle métallique solidaire de la poubelle qui devra être du modèle réglementaire. La poubelle ne contiendra que les ordures ménagères et devra être fermée. Le dépôt de ces récipients devra être effectué une heure au plus avant l’heure réglementaire de l’enlèvement qui doit commencer à 6h30… »[28].
Dans la zone urbaine n° II, les dispositions en termes d’aménagement de la voirie publique sont autres. L’article 75 du même texte dispose que les habitants sont tenus de déposer chaque jour avant 9 heures, leurs ordures ménagères dans les dépotoirs construits à cet effet.
Ce n’est pas par faute de bonne intension que de telles dispositions ont été prises ; tout réside dans leur application. Le fonctionnement d’un service de voirie suppose des moyens financiers qui font défaut au territoire. Une note du chef de la circonscription de Douala à Monsieur le commissaire de la république nous permet d’apprécier l’étendue de la question :
« Il ne se passe de jours que le service de la voirie, le service d’hygiène ou le commissaire de police n’aient à intervenir pour débarrasser les abords des voies publiques de tas d’énormes immondices que les propriétaires riverains mettent la plus extrême mauvaise volonté à enlever. Cette situation n’est pas momentanée, elle existait lors de mon premier séjour et mes prédécesseurs l’ont également subie. Or, de conversation avec les habitants il en résulte que ces derniers ne peuvent, la plus part du temps, se plier au règlement en vigueur faute de moyens de transport. Les entrepreneurs utilisent leur matériel pour les manipulations de marchandises et ne consentiraient à porter des déchets végétaux ou autres que moyennant un prix trop élevé. Reste le service de la voirie. Il est incontestable que le moyen le plus régulier, le plus efficace serait d’assurer nous-même l’enlèvement des immondices. Nous réaliserons ainsi le vœu de la population. Le président de la chambre de commerce m’a certifié que personne n’hésiterait à verser les taxes nécessaires pour n’avoir plus à s’occuper d’un nettoiement difficile à effectuer…A Douala, les transporteurs exigent généralement, par voyage une moyenne de trente francs. Nous pourrions fixer à 16 francs, augmenté de la majoration de 25% réglementaire, soit au total 20 francs, la taxe à imposer par trajet du lieu où se trouverait la matière à évacuer, au dépotoir »[29].
Il faut noter que la population en souffrance dans cette note, et qui est prête à payer une taxe pour voir ses immondices disparaitre ne peut être que la population de la zone urbaine n° I, constituée d’européens en majorité. Il est difficile de penser que la population indigène et paupérisée de la zone urbaine n°II soit elle aussi prête à payer une taxe de 20 francs, ce qui représente une somme importante. Le problème de l’enlèvement des ordures ménagères reste d’actualité même pendant la période de la tutelle française. Les quartiers comme New-Bell, sont restés célèbres pour leur insalubrité et foyer d’éclosion des épidémies.
Pour combattre cette situation, l’administration a imposé le balayage obligatoire. Des habitations, des alentours des maisons, magasins, et jardins, le nettoyage des caniveaux et jardins et égouts… Le non-respect des règles d’hygiène édictées conduit à des incarcérations[30]. Ce qui a contribué à améliorer l’état sanitaire de la ville de Douala.
3- Discussion des résultats.
3.1. De la démarche méthodologique.
Pour comprendre à quel degré les questions d’hygiène publique ont influencé l’aménagement de l’espace urbain à l’époque du mandat français, nous nous sommes limités à un procédé opératoire dit qualitatif, qui nous a fourni des données non chiffrées que nous avons soumis à un traitement rigoureux pour en dégager une signification scientifique. Cependant, parce que nos informations sont issues en grande partie des rapports de l’administration mandataire, elles expriment un point de vue motivé d’un seul acteur, ce qui amène à relativiser les liens dégagés. De plus, les sources documentaires utilisées n’ont pas été recueillies en majorité par enquête, donc n’ont pas été élaborée en vue de la recherche. Nous avons essayé de surmonter cette insuffisance dans la mesure où les informations retenues ont été soumis à une critique rigoureuse pour pouvoir en faire bon usage. Toutefois, vue la période étudiée et les problèmes d’archivage qui se pose avec acuité, l’étude documentaire reste la seule technique de collecte des données qui s’offrait à nous.
3.2.Les résultats obtenus et leur interprétation.
Les problématiques liées à l’urbanisme colonial dans ses rapports avec l’imaginaire colonial n’ont pas encore suscité un grand intérêt scientifique. Les productions allant dans ce sens sont maigres. Très souvent, on se heurte à un réel problème de documentation, renforcé par celui de l’archivage qui se pose avec de plus en plus de netteté. De plus, pour mieux aborder ces problématiques, il faut faire intervenir les techniques socio-psychologiques d’investigation dans le champ historique. Cependant, les témoins sont rares et les statistiques inexistantes, ce qui handicapent les recherches.
Le mérite de cette étude est de poser le problème de l’univers mental dans la politique d’aménagement de l’espace urbain, de comprendre comment celui-ci peut s’organiser à partir de ses schémas et de prévoir les conflits sociaux qui peuvent en résulter du fait des frustrations. Ces frustrations sont perceptibles aujourd’hui chez les Bonadoo du Canton Bell, qui ont été expropriés du plateau Joss. L’Etat postcolonial a donc hérité des litiges fonciers entre l’administration coloniale et les populations autochtones. Pour calmer ces frustrations et minimiser les risques de conflits sociaux, il est logique d’envisager un dédommagement de quelques natures que ce soit des populations lésées.
CONCLUSION
Il était question de montrer comment les représentations qu’on se fait d’un groupe peuvent influencer l’aménagement des espaces urbains dans un contexte biracial, voire multiethnique, et comment ces représentations peuvent influencer l’occupation du sol. Le cas de la ville de Douala n’est qu’un cas d’étude pour amorcer la réflexion. L’installation des européens sur de nouvelles terres ne pouvait se faire que si leur sécurité sanitaire était garantie. L’imagerie coloniale a conservé les fresques d’une écologie intertropicale hostile à «l’homme blanc». D’ailleurs, même les plus illustres praticiens de la médecine, mettaient en garde les élèves médecins des troupes coloniales françaises en ces termes : «là-bas, sur les rives empestées de l’Atlantique, vous rencontrerez le redoutable sphinx de la malaria, pernicieux portée, le fantôme délirant du typhus, le masque jaune du vomito négro. Défiez-vous ! De la terre et des eaux s’exalte un souffle empoisonné… »[31]. Il en résulte à l’évidence une phobie des Hommes et des pathologies intertropicales, laquelle phobie a largement impacté sur l’aménagement de l’espace urbain de Douala.
Bibliographie
1-Documents d’archive :
- A.N.Y : 3AC1452, enlèvement d’ordures et déchets divers a Douala, 1929.
-A.N.Y :1 AC2138, règles d’hygiène applicables dans le mandat.
- A.N.Y : AC 4996, Réglementations de l’hygiène et de la salubrité publique, 1937.
- A.N.Y : 1AC5676, Arrêté n° 371 d’octobre 1937 fixant les règles générales d’hygiène et de salubrité dans le territoire du Cameroun sous-mandat français.
2-Rapports de la France à la S.D.N.
- Rapport SDN ,1933.
3-Périodiques :
- J.O.C, 1917
.
- J.O.C, 15 Novembre 1928.
4- Ouvrages :
- Douala Manga Bell R.(2007), Le prince Alexandre, , Douala, Africavenir, 2007.
- Gouellain R.(1975), Douala, ville et histoire, Paris, institut d’ethnologie.
- Martin G. (1921), l’existence au Cameroun, Paris ,Emile larose .
[1]R. Gouellain, Douala, ville et histoire, Paris, Institut d’ethnologie, 1975, P 16.
[2]. DZA Postdam. Reich Kolonial Amt n°4427b1. 3ff. Bericht Von Gouverneur Seitz, cité par prince R. Douala Manga Be, Le prince Alexandre, , Douala, Africavenir, 2007, P 190.
[3]R. Gouellain, Douala, vile et histoire, Paris, institut d’ethnologie, 1975, P 131.
[4]Ibid ,p131.
[5]G. Martin, l’existence au Cameroun, Paris ,Emilelarose ,1921, p364.
[6] A.N.Y : AC 4996, Réglementations de l’hygiène et de la salubrité publique, 1937.
[7]G. Martin, l’existence au Cameroun… P 219.
[8] A.N.Y : 1AC5676, Arrêté n° 371 d’octobre 1937 fixant les règles générales d’hygiène et de salubrité dans le territoire du Cameroun sous-mandat français.
[9] J.O.C, 15 Novembre 1928
[10] A.N.Y :1AC5676…article 58
[11]Ibid ,article 6
[12] Il doit s’agir ici d’une erreur de saisie du texte. L’observation faite des habitations de type colonial du quartier Bonajo montre que le sol est élevé à 0,60 m et non 0,60 cm.
[13] Dans la zone urbaine n° II, le sol des habitations doit être a 0,50 m du niveau de la cour et de la rue.
[14] Dans la zone urbaine n° II, le plafond doit être a 3m du sol.
[15] A.N.Y : 1AC5676, Arrêté n° 371… article 61.
[16]Ibid ,article79
[17] J.O.C, 1917, P14.
[18]JOC, 1917, P17.
[19]G. Martin, L’existence au Cameroun… p340.
[20] Ibid.
[21] Rapport SDN ,1933 ,P 31.
[22]Rapport SDN, 1933, P280.
[23]Ibid ,article 1er .
[24]Ibid ,article 2 .
[25]Ibid , article 14 .
[26]Ibid , article 19 .
[27]Ibid , article 20 .
[28]Ibid, p 20
[29] A.N.Y : 3AC1452, enlèvement d’ordures et déchets divers a Douala, 1929.
[30]A.N.Y :1 AC2138, règles d’hygiène applicables dans le mandat, P2.
[31]Propos tenus par le professeur MAHE en 1875 à l’école de Médecine navale de Brest, cité par Mathis C., L’œuvre des Pastoriens en Afrique, Afrique Occidentale Française , Paris, PUF, 1946,p7.